Vers une Médecine de Transplantation plus Équitable, Précise et Innovante
La transplantation d’organes solides est une avancée médicale majeure, mais reste confrontée à des défis persistants liés à l’accès équitable, la pénurie d’organes et l’optimisation du suivi post-greffe.
Trois publications publiées aujourd’hui, dont l’une portée par le Pr. Alexandre Loupy, Professeur des universités praticien hospitalier (AP-HP/ UFR de Médecine) et néphrologue à l’hôpital Necker, dans The Lancet dressent un panorama complet des avancées scientifiques, technologiques et politiques dans ce domaine.
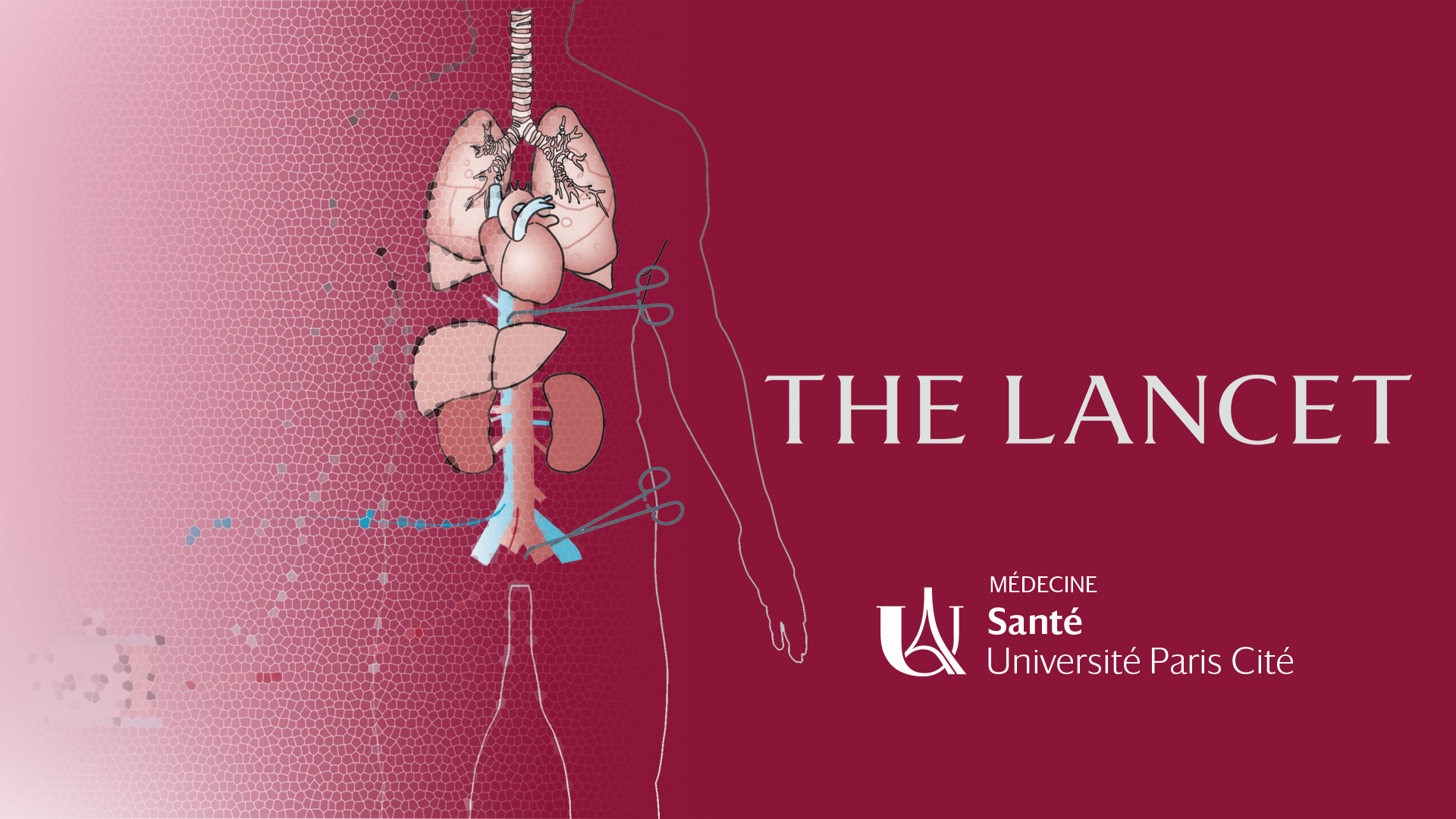
©
Une crise mondiale d’accès et de disponibilité
Seule une infime partie des besoins mondiaux en transplantation est actuellement couverte : moins de 10 % selon l’OMS. Les obstacles sont nombreux, allant de l’absence d’infrastructure nationale dans de nombreux pays à des critères trop stricts d’acceptabilité des greffons. À titre d’exemple, environ 50 000 organes sont rejetés chaque année rien qu’aux États-Unis et en Europe, souvent à cause de jugements cliniques incertains.
Des solutions technologiques émergent : la perfusion ex vivo permet de restaurer et d’évaluer des organes auparavant jugés non viables. Des efforts sont également déployés pour mieux utiliser les organes de donneurs avec hépatite C ou VIH, grâce à des traitements antiviraux efficaces. Ces approches ont permis d’élargir le nombre de greffes, mais ne suffisent pas à répondre à la demande.
La médecine de précision post-transplantation
Malgré une réduction drastique des rejets aigus depuis les années 1980, les effets secondaires à long terme des immunosuppresseurs (infections, cancers, maladies cardiovasculaires) nuisent à la survie des greffons et à la qualité de vie des patients. Le virage vers une médecine personnalisée, fondée sur des biomarqueurs innovants et l’intelligence artificielle, promet une meilleure stratification des risques et des traitements plus ciblés.
Des outils comme l’algorithme iBox pour les greffons rénaux, récemment validé comme critère d’essai clinique par l’EMA et la FDA, représentent un tournant. De même, le développement de tests sanguins non invasifs visant à détecter précocement les rejets permettrait de réduire le recours aux biopsies, souvent lourdes et peu informatives.
L’enjeu crucial de l’équité
Les auteurs insistent sur le rôle des déterminants sociaux dans les inégalités d’accès : les minorités raciales, les populations rurales et les patients à faible revenu sont systématiquement désavantagés dans les pays riches, comme aux États-Unis. Le manque de coordination entre professionnels de santé, l’opacité des critères d’éligibilité, les barrières financières et la méfiance institutionnelle aggravent ces écarts.
La transformation de la transplantation d’organes passe donc par une triple révolution : technologique, médicale et politique. Pour qu’elle profite à tous les patients, les avancées scientifiques doivent être soutenues par des politiques équitables, un meilleur partage des ressources et une transparence accrue. Comme le résument les auteurs : « la transplantation est un succès de la médecine moderne — à condition de ne pas en faire un privilège. »
Trois webinaires seront proposés sur ces sujets, en juillet par société Européenne (ESOT), internationale (TTS), et Américaine (AST) et The Lancet.
À lire aussi

Vers une école de chirurgie d’excellence : le Campus chirurgical du Grand Paris
Ancré sur le site historique de l’ancien hôpital Broussais dans le 14ᵉ arrondissement, le Campus chirurgical du Grand Paris incarne un tournant majeur pour la formation, la recherche et l’innovation en chirurgie. Cette nouvelle École de Chirurgie, fruit...

Retour sur la Journée Portes Ouvertes du 7 février
Le 7 février, la Faculté de Santé a accueilli le public sur le site des Cordeliers à l’occasion de sa Journée Portes Ouvertes, un rendez-vous très attendu par les futurs étudiants et leurs familles. Cet événement a rassemblé les quatre composantes :...

Préparer les futurs médecins à gérer des urgences terroristes : une formation essentielle à l’UFR de Médecine de l’Université Paris Cité
Face à l’évolution permanente des risques collectifs, y compris les attentats ou situations de violence de masse, la préparation des professionnels de santé à intervenir efficacement en cas d’urgence extrême est plus que jamais une priorité. Dans ce cadre,...

Retour sur la deuxième édition de la Journée de la Recherche
La deuxième édition de la Journée de la recherche de l’UFR de Médecine de l’Université Paris Cité, organisée le lundi 26 janvier à Odéon, a réuni la communauté universitaire autour d’un programme riche, illustrant la diversité, l’excellence et le dynamisme...
