
Quatrième saison du séminaire de recherche en anthropologie « La mort, la perte et le deuil : perspectives anthropologiques », associé au programme ANR PHANTASIES et lauréat de l’appel à projet Dynamique en recherche lancé par l’université dans le cadre de l’IdEx.

Séminaire de recherche animé par Serena Bindi (Université Paris Cité, Centre d’Anthropologie Culturelle CANTHEL) et Aidan Seale-Feldman (University of Notre Dame)
Si les pratiques funéraires et les conceptions socioculturelles de la mort ont été un thème de recherche central pour l’anthropologie, beaucoup moins d’attention a été consacrée par les anthropologues aux manières dont les vivants réagissent à la perte d’un proche. Néanmoins une réflexion sur ce thème semble d’autant plus importante que, à l’heure actuelle, le monde occidental, entre autres, est traversé par de vifs débats scientifiques et de société sur les façons de faire face à l’expérience de la mort d’un être cher. Des troubles mentaux liés au deuil ont été récemment inclus dans les deux manuels internationaux de diagnostic psychiatrique, aboutissement historique, selon certains, d’une tendance à médicaliser l’expérience de la perte et à normaliser son déroulement.
Mais si cette expérience de la perte est bien universelle, est-il possible de définir de façon absolue comment elle est ou devrait être vécue ? La notion même du « deuil » revêt-elle un sens dans tout contexte social ? Et si des réactions somatiques et émotionnelles spécifiques sont souvent considérées comme allant de pair avec l’expérience de la perte, comment la gestion de ces états du corps et de la sensibilité varie-t-elle selon les sociétés ? Et qu’advient-il quand se rencontrent au sein d’une même société des modes de gestion divergents, voire conflictuels de la perte ? Que ce soit dans le cadre de situations de contact entre cultures ; ou parce que diverses institutions (thérapeutiques, religieuses, politiques…) façonnent différemment au sein d’un même milieu humain l’appréhension, la perception et le vécu de l’expérience de la perte et des « symptômes » qui l’accompagnent.
Les séances de ce séminaire aborderont ces questions à partir de contributions anthropologiques, théoriques et empiriques, portant tant sur l’Europe que sur d’autres régions du monde. Cela permettra d’interroger les prémisses épistémologiques sur lesquelles une anthropologie de la perte et du deuil pourrait être construite et les types d’apports théoriques que nous pouvons attendre et qui ont déjà été apportés par la discipline ; cela permettra aussi de réfléchir aux possibilités méthodologiques spécifiques utilisables ethnographiquement pour produire des données sur le sujet. Mais nous ne nous confinerons pas à la discipline anthropologique.
Les séances accueilleront régulièrement des chercheurs adoptant d’autres démarches, philosophiques, psychanalytiques, filmiques, littéraires, artistiques. Ce faisant, le séminaire a pour espoir de pouvoir construire un espace propice à une réflexion ouverte et collective autour de la complexité et des dimensions multiples de l’expérience de la perte, ainsi que des différentes façons de la vivre, de lui donner une forme et de la communiquer.
PROGRAMME 2023-2024
19 octobre, 16h-20h
Funérailles royales et traitement du corps (Baoulé, Côte d’Ivoire). (16h-18h)
Fabio VITI (Aix-Marseille Université, Institut des Mondes Africains IMAF)
Figures du care dans le deuil: l’exemple du grand âge. (18h-20h)
Marc-Antoine BERTHOD (Laboratoire de recherche santé-social, Haute école de travail social et de la santé Lausanne HETSL | HES-SO)
26 octobre, 16h-18h
Une anthropologie de la perte et du deuil en période de Covid-19 (France, Suisse, Italie). Apports théoriques, possibilités méthodologiques et ajustements in situ.
Gaëlle CLAVANDIER (Université Jean Monnet, Centre Max Weber)
ATTENTION: cette séance aura lieu uniquement en distanciel > lien zoom
Résumé de l’intervention
Le deuil et les pratiques funéraires font partie intégrante des travaux en sociologie et en anthropologie, ce dès l’émergence de ces disciplines, voire en lien avec leur institutionnalisation. Des textes fondateurs ont été publiés dès les premières décennies du XXème siècle. Cependant, ces deux disciplines peinent depuis, et encore aujourd’hui, à assoir leur légitimité sur ces terrains et questionnements.
A partir d’une situation exceptionnelle, une pandémie mondiale (Covid-19), il est montré que le caractère ordinaire et extraordinaire des décès qu’elle occasionne permet d’analyser à nouveaux frais la perte et le deuil dans des sociétés sécularisées. Tant la manière de conduire «l’enquête», que l’analyse des données collectées montrent les apports d’une démarche ethnographique. Loin de postuler ou de tester l’hypothèse d’une amplification des complications du deuil, il s’agit de donner place aux récits, de les contextualiser, tout en s’autorisant de les replacer dans un contexte plus large, celui d’une gestion de crise. Ce contexte, où le moment du décès, la cause du décès, le lieu du décès, les ressources des personnes endeuillées, le caractère itératif de la perte, la manière dont sont présentés ces deuils dans l’espace médiatique, etc. n’est pas sans effet sur les récits de la perte et du deuil et sur les pratiques funéraires. Ainsi, et ce dès l’entame de cette crise, avoir présenté le contexte des décès et de la prise (non prise) en charge des corps comme générateur de troubles, selon une grille de lecture qui vise à pathologiser certains états de deuils, n’est pas sans effets « sociaux ». De ce point de vue, redonner du crédit à une approche sociologique et anthropologique du deuil et des pratiques funéraires est primordial afin d’une part de ne pas (in)valider un seul type d’hypothèses, et d’autre part de pas faire porter la « charge» du vécu de la perte, du deuil et par extension sa «qualité» et sa «résolution», aux seules personnes a priori directement concernées.
9 Novembre, 16h-20h
Eco-Anxiety and Climate Urgency in the Mother City of Cape Town. (16h-18h)
Kerry CHANCE (University of Bergen, MIT, CANTHEL)
Les morts qui aident, les morts qui soignent. D’après des récits de contemporain.e.s. (18h-20h)
Magali MOLINIE (Université Paris 8, Cornell University)
23 Novembre, 17h45-19h45
Enterrer à tout prix. Deuil, investissement et honorabilité au Bénin
Joël NORET (Université Libre Bruxelles, Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains)
30 Novembre, 16h-20h
Le deuil est il un travail ? (16h-18h)
Laurie LAUFER (Université Paris Cité, UFR IHSS, Centre de Recherche Psychanalyse Médecine et Société)
« Mes Êtres Chers … La mort ne survient pas d’un seul coup. Je meurs par degrés » : La lettre comme forme pour faire le deuil d’une existence. (18h-20h)
Anthony STAVRIANAKIS (CNRS, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative LESC)
14 Décembre, 16h-20h
Reconfiguration du partage émotionnel dans les rites funéraires occidentaux : du postmortem au pré-mortem. (16h-18h)
Marika MOISSEEFF (CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale LAS)
« La mort surréaliste » : Trauma et deuils en migration suite aux morts de COVID-19. (18h-20h)
Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY (INALCO, Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques CESSMA, IC Migrations)
Les séances sont ouvertes à tous et proposées simultanément en présentiel et en distanciel.
En présentiel : salle Mendel A, Campus saint germain des prés, 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris
A distance : cliquez sur ce lien sans besoin d’aucune inscription
À lire aussi

Félicitations à Marion Maisonobe, lauréate de la médaille de bronze du CNRS
Marion Maisonobe est chargée de recherche CNRS au sein de l’UMR Géographie-Cités (Université Paris Cité/CNRS / EHESS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), le laboratoire interdisciplinaire au carrefour de la géographie humaine et des études urbaines.

Festival Double•Science 2025, une nouvelle édition riche en animations !
Les 14 et 15 juin derniers, l’Université Paris Cité a participé au Festival Double•Science, au Ground Control à Paris, au travers de multiples jeux, ateliers, dédicaces et d’un podcast. Retour sur cette 3e édition qui a réuni plusieurs actrices et acteurs de la...
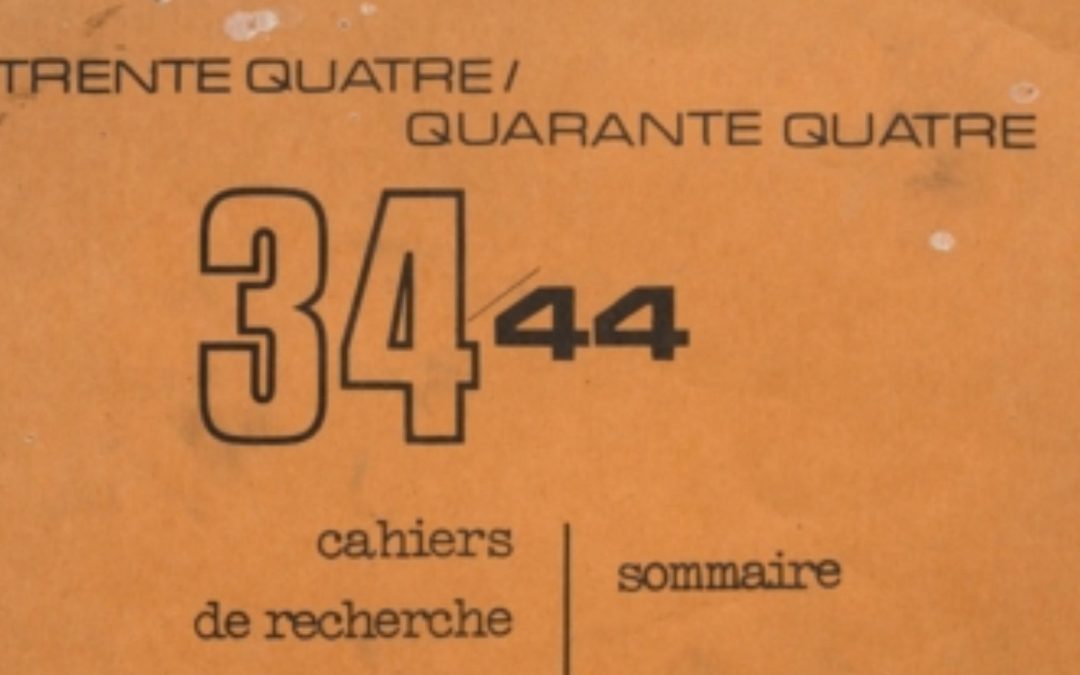
Textuel, 37 ans de recherche disponibles en ligne sur le portail Persée
Les Collections Textuel et Cahiers Textuel, publications périodiques de l’UFR LAC et du laboratoire CERILAC devenues introuvables, sont désormais librement accessibles en ligne sur le portail de référence en sciences humaines Persée.

Félicitations à nos quatre lauréates IUF 2025 !
Cette année, parmi les 11 enseignantes-chercheures et enseignants-chercheurs d’UPCité nommés membres de l’Institut Universitaire de France (IUF), 4 sont issues des laboratoires de la Faculté S&H : Ioana Chitoran, Marie-Luce Gélard, Manon Lelandais et Ariane Mak.
