Les troubles cognitifs subtils, difficiles à diagnostiquer au moyen des tests neuropsychologiques actuels, pourraient être détectés grâce à des indices fins dans notre langage. De nombreuses équipes de recherche se sont penchées sur cette problématique, sans pour autant utiliser les mêmes termes et méthodes, freinant ainsi la reproductibilité de leurs études. Dans un article publié le 9 décembre 2024 dans le Journal of Speech, Language, and Hearing Research, une équipe interdisciplinaire composée de trois chercheuses du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, et de Manon Lelandais, maître de conférences en linguistique à l’UFR Études anglophones et membre du CLILLAC ARP, propose une terminologie harmonisée.

Les chercheuses ont analysé 51 études sur le sujet qui ont été réalisées sur les 10 dernières années. Leur objectif était d’identifier les « marqueurs linguistiques » – des caractéristiques dans la parole qui pourraient différencier une personne en bonne santé cognitive d’une personne présentant des troubles subtils (aussi appelés troubles neurocognitifs mineurs). Parmi ces études, la grande majorité portaient sur des maladies liées à l’âge et incluaient un nombre réduit de participants, souvent moins de 30.
Les résultats sont impressionnants : l’équipe de chercheuses a recensé 384 caractéristiques linguistiques distinctes, regroupées sous 335 noms différents. Cela va des pauses d’hésitation aux substitutions de mots, en passant par des erreurs syntaxiques.
Cependant, toutes ces caractéristiques ne sont pas équivalentes. Certaines semblent très utiles pour repérer les troubles cognitifs, tandis que d’autres sont moins fiables. Un problème majeur est le manque d’uniformité dans les termes et les méthodes utilisés entre les différentes études. Cela rend difficile de comparer les résultats ou de tirer des conclusions définitives.
Les chercheuses soulignent donc l’urgence d’harmoniser les méthodes d’analyse et les terminologies. Elles proposent des solutions pour améliorer la reproductibilité des travaux, notamment en testant la fiabilité des marqueurs linguistiques sur des groupes plus larges et plus diversifiés.
Ces travaux ouvrent une nouvelle voie passionnante : utiliser notre parole comme un outil de dépistage. À l’avenir, des algorithmes ou des outils d’IA pourraient permettre aux professionnels de santé de détecter rapidement les premiers signes de troubles cognitifs, avant même qu’ils ne soient visibles dans la vie quotidienne.
À lire aussi

Le Monde, Le point, Médiapart, France culture… Le dernier ouvrage de Pinar Selek au cœur de l’actualité politique
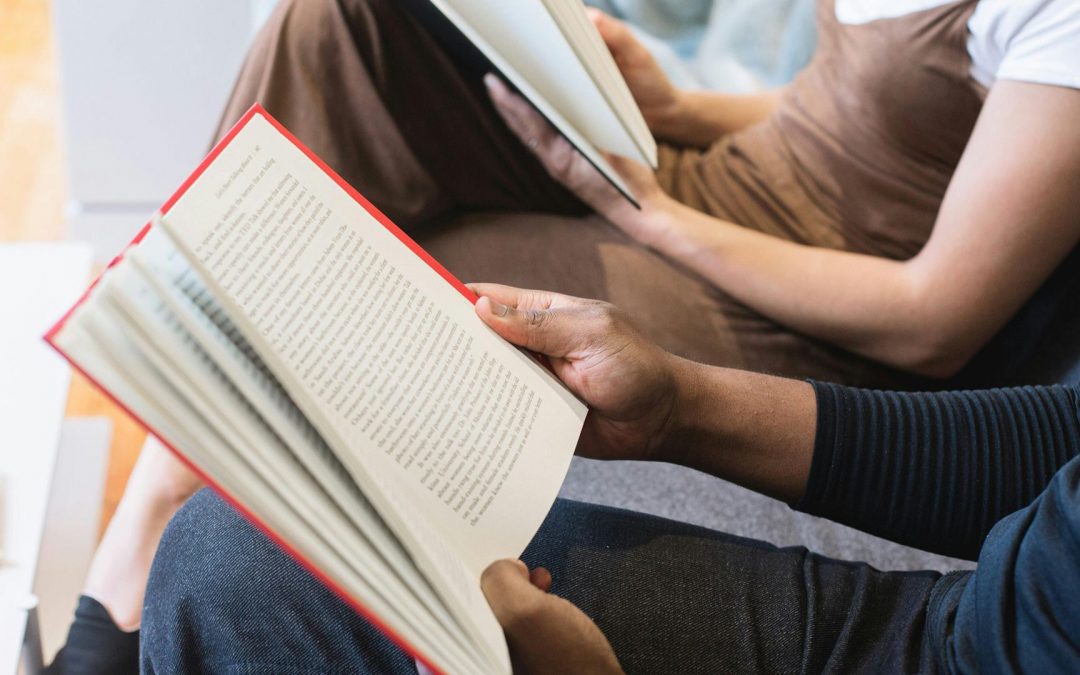
Quart d’heure de lecture national : ce que ces 15 mn de lecture font à notre cerveau
Le 10 mars, le Quart d’heure de lecture national invite chacune et chacun à interrompre ses activités pour consacrer 15 minutes à la lecture. À l’Université Paris Cité, cette initiative prend une dimension particulière : défi de lecture, éclairage scientifique sur les effets de la lecture sur le cerveau et (re)découverte des ouvrages d’Université Paris Cité Éditions.

AAP BRIO|Budget Restreint, Impact Optimal
L’Atrium Humanités et Sciences sociales (HSS) lance l’appel à projets BRIO 2026 visant à soutenir financièrement, pour un montant minimal de 2000 € et maximal de 5000 € par demande, des projets et actions de recherche structurants pour un laboratoire : achat de...

Soirée de lancement du nouvel ouvrage de Pinar Selek aux Éditions de l’Université Paris Cité
Le 16 février dernier, la soirée de lancement de Lever la tête, le nouvel ouvrage de Pinar Selek, s’est tenue en présence d’Édouard Kaminski, président de l’université, devant un Grand Amphithéâtre comble.
