La Faculté de Santé crée l’Institut Hors Murs (IHM) Santé des Femmes. L’objectif de cet IHM est de fédérer au sein de l’université l’expertise de cliniciens et de chercheurs d’un large éventail de disciplines pour offrir l’excellence et l’innovation dans la recherche, la pratique clinique, l’éducation et la formation afin de faire une différence réelle et durable pour la santé des femmes et des nouveau-nés à l’échelle locale et nationale et dans le monde entier.

La santé des femmes au cœur des défis de notre société
Les femmes et les hommes présentent des différences importantes dans les facteurs qui déterminent la santé et l’impact des maladies. La prise en compte de la dynamique du genre en matière de santé est donc essentielle.
Ces deux dernières années ont notamment été marquées par :
- la mise en place en 2020 d’une politique de santé autour des 1000 premiers jours de vie, mettant en avant l’importance de l’environnement maternel dès la vie intra utérine pour le développement harmonieux de l’enfant ;
- la promulgation en août 2021 de la nouvelle loi de bioéthique qui élargit l’accès à l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), permet l’autoconservation des gamètes en dehors de tout motif médical, facilite les recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires ;
- l’annonce en janvier 2022 d’une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose ;
- l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’infertilité en 2022.
La santé des femmes est ainsi au cœur de défis de société majeurs.
Cinq axes pour relever ces défis
Les activités de l’Institut Santé des Femmes seront organisées autour de 5 grandes thématiques :
- Santé sexuelle et reproductive
Cet axe de recherche s’intéresse à la sexualité, aux pratiques contraceptives, au recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation, à l’avortement, à l’accès à l’information et aux services de santé, et à la capacité des femmes à s’épanouir dans leur sexualité, en se protégeant des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. S’appuyant sur la définition de l’OMS, cet axe de recherche appréhendera les différentes dimensions de la santé sexuelle et reproductive, c’est à dire la dimension physique mais aussi mentale et sociale. Il intègre le thème des violences faites aux femmes. Une attention particulière est portée aux rapports de genre au sein de la santé sexuelle et reproductive.
- Santé gynécologique
Cet axe de recherche s’intéresse aux pathologies et troubles fonctionnels spécifiques des organes sexuels et reproducteurs de la femme. Une attention particulière sera portée au dépistage précoce et à la prise en charge de l’endométriose. Ces dernières années, l’endométriose s’est imposée comme un enjeu de santé publique en France, et en 2022, un plan d’action national a été proposé, afin d’améliorer sa prise en charge. Cet axe de recherche se consacrera également à la prise en charge des fibromes utérins, du syndrome des ovaires polykystiques, et des cancers gynécologiques de la femme.
- Santé Périnatale
Cet axe s’intéresse au déroulement de la grossesse, aux comportements et aux événements de santé maternelle, depuis la conception jusqu’à l’accouchement et ses suites, en étudiant les populations à haut et à bas risque obstétrical. Une attention particulière sera portée à la santé des femmes à plus long terme en lien avec cette période. Les travaux portent également sur les événements de santé néonatale, qui conditionnent en grande partie la santé de l’enfant à plus long terme (1000 premiers jours de vie) ; cet axe couvrira notamment la prématurité, le petit poids de naissance, les pathologies fœtales et placentaires. Mieux comprendre les pathologies et les évènements survenant pendant cette période, pour la mère et l’enfant, permet de développer des traitements et des actions de prévention contribuant à un meilleur état de santé de la population sur le court et le long terme. Un intérêt particulier portera sur les inégalités sociales dans ces domaines.
- Santé mentale
Cet axe a pour but de se consacrer aux spécificités de la santé mentale des femmes. A la fois à travers l’impact des différentes périodes de vie des femmes : la puberté, les cycles menstruels, les grossesses, les interruptions de grossesse, les parcours de PMA, les deuils périnataux, la contraception et la ménopause. Mais également, en étudiant les spécificités des troubles psychiatriques chez la femme : leurs déterminants, leurs facteurs de risque et leurs prises en charge. Enfin, certaines pathologies de la femme, tels que les SOPK, l’endométriose, certains cancers de la femme, ont un impact spécifique sur la santé mentale des femmes, faisant l’objet d’un intérêt particulier.
- Spécificité de la femme dans les maladies chroniques
Comme l’axe « santé mentale », cet axe de recherche s’intéresse à l’étude des spécificités de la femme dans les maladies non directement liées à la reproduction et aux organes sexuels, mais qui impactent les deux sexes de façon différente. Sont notamment étudiées, les différences entre sexes et genres en termes de physiopathologie, épidémiologie, approche diagnostique, prise en charge thérapeutique, accès aux parcours de soins, impact du style de vie, de l’environnement, des facteurs socioculturels. Cette approche concerne en premier lieu les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et sera étendu, entre autres, aux maladies neurologiques, endocrinologiques, auto-immunes, infectieuses et ostéoarticulaires et au cancer. Des aspects plus spécifiques liés à la pharmacologie, les traitements chirurgicaux et les nouvelles technologies en santé seront aussi abordés.
En complément de ces 5 axes, sont également définis 2 axes transversaux, dont les thèmes ont vocation à être investis au sein des cinq axes principaux :
- Vivre en bonne santé : cet axe a pour perspective la santé dans sa dimension de bien-être, et vise à développer la prévention et la promotion en santé. Il s’agit par exemple des travaux portant sur l’activité physique des femmes, et son impact sur leur santé.
- Environnement : cet axe vise à promouvoir la prise en compte et l’étude du rôle de l’environnement, dans ses dimensions sociales et physiques, sur la santé des femmes et sur les soins qu’elles reçoivent.
À lire aussi

Une tradition des études de santé : les amphis de garnison
La Faculté de Santé organise des amphis de garnison à chaque fin d’année universitaire. Les grands admis du parcours d’accès spécifique santé (PASS) et des licences à mineure accès santé (LAS) sont conviés pour exprimer tout haut leurs souhaits de...

Participez à la journée de Sensibilisation à la Science Ouverte de Circle U. !
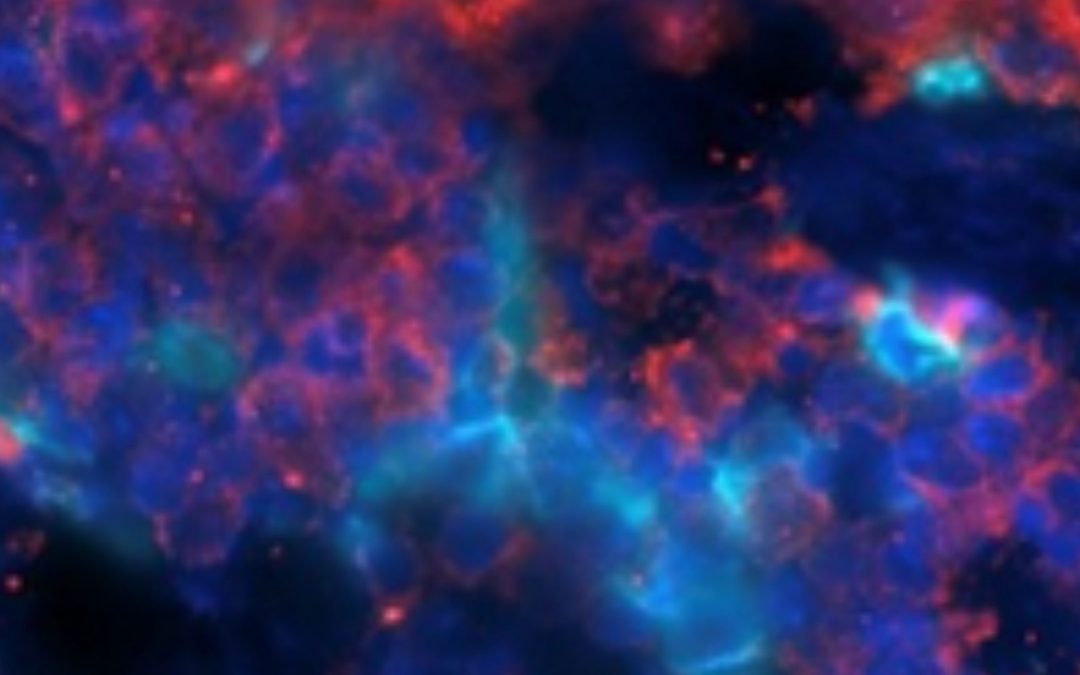
Malformations artérioveineuses : nouvelle approche thérapeutique prometteuse pour les patients

