Colloque « HabitabilitéS »
Pour conclure son cycle 2022/2023 de séminaires autour des hybridations plurielles de l’« habitabilité », le Centre des Politiques de la Terre a organisé les 21, 22 et 23 juin 2023 un colloque entremêlant jeunes chercheur.se.s et chercheur.se.s confirmé.e.s – issu.e.s des sciences naturelles et expérimentales, des sciences sociales et humaines & des sciences de la santé – ainsi que des acteur.trice.s public.que.s, des militant.e.s et des artistes. Ce colloque aboutira sur la publication d’un ouvrage collectif.

© Anne-Sophie Milon
Savoir-habiter avec la Terre
21, 22 et 23 juin 2023
Face à l’aggravation et la multiplication des crises écologiques à l’échelle planétaire, les appels à des recherches ouvertes, entre disciplines et vis-à-vis du reste de la société, se sont multipliés (Kates, 2011). Sécheresses, feux de forêts, inondations, mais aussi contaminations des milieux, déséquilibres des cycles biogéochimiques et dépassements de plusieurs limites planétaires, sont autant de phénomènes nécessitant des collaborations inédites entre sciences de la Terre, du vivant, de la santé et sciences humaines et sociales, ainsi que de nouveaux concepts favorisant ces collaborations. Notion frontière, l’« habitabilité » vise à permettre un dialogue interdisciplinaire : ce concept renvoie aux limites physiques qui favorisent la vie et aux conditions politiques, sociales, économiques de reproduction du vivant (Blanc et al., 2022, p. 10). Il met en outre à l’épreuve les collaborations entre scientifiques et non scientifiques, habitant.e.s, militant.e.s ou acteur.rice.s public.que.s pour préserver l’habitabilité des milieux, et ce pour différentes espèces, dans un contexte de perturbation des équilibres planétaires.
Le nombre de propositions reçues pour ce colloque a témoigné de l’intérêt de la notion et du caractère désormais brûlant des enjeux relatifs à l’écologie politique. Que l’on parle du changement climatique, de la chute de la biodiversité ou de l’Anthropocène, ces « événements » ont ouvert des brèches inédites dans nos manières de nous représenter le monde et d’y agir (Fressoz, Bonneuil, 2013). Dans un contexte de mobilisations, mais aussi de répression croissante des mouvements sociaux en lutte pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale (Fouillen et al. , 2022), ce colloque s’est voulu la preuve par l’exemple des possibilités d’exploration commune ouvertes par ces brèches. Il a exploré les imaginaires et les pouvoirs responsables des transformations environnementales et planétaires, ainsi que les formes d’action collective permettant de les comprendre et d’y (ré)agir. Dans un jeu d’échelles constant entre observations, pensées locales, globales et néanmoins situées (Haraway, 1988), il a aussi visé à appréhender les différents « états » de la Terre et le rôle de la vie dans ses trajectoires (Clark, Szerszynski, 2020). Enfin, les pratiques scientifiques et profanes ont été mises en regard avec des pratiques artistiques et militantes, ordinaires et de l’action publique, visant la production et le maintien d’une planète et de milieux habitables, leurs fondements et leurs potentialités.
Les cinq sessions interdisciplinaires ont discuté la production des mondes futurs, la vie dans les ruines ou les écosystèmes en cours d’effondrement, les pratiques de production, d’organisations et de maintien des milieux et environnements, les trajectoires terrestres et planétaires et les normes scientifiques régissant l’action collective. Les tables rondes ont été des assemblées autour de la création de Centres à vocation d’interdisciplinarité écologique et des questions féministe et de décolonialité. Le colloque s’est également ouvert à des artistes et d’autres pratiques sensibles. Le jeudi s’est conclut par la visite d’une installation et le vendredi par une représentation théâtrale.
En somme, ce colloque s’est voulu une fenêtre, une boîte de Petri, mais aussi une caisse de résonance des recherches et des formes d’actions collectives engagées pour comprendre les transformations terrestres et pour « savoir-habiter avec la Terre ».
Comité scientifique
Alexandra Arènes
Isabelle Arpin
Sébastien Dutreuil
Malcom Ferdinand
Cédric Gaucherel
Olivier Hamant
Sophie Houdart
Maïté Juan
Thomas Lamarche
Nathalie Ortar
Géraldine Pfleiger
Bernard Reber
Marine Sarfati
Comité d’organisation
Les membres du bureau du Centre des Politiques de la Terre


À (re)lire

L’habitabilité en question à l’échelle d’un territoire de l’Anthropocène
Centre des Politiques de la Terre (2023)
Document de travail • Campus Anthropocène 2022
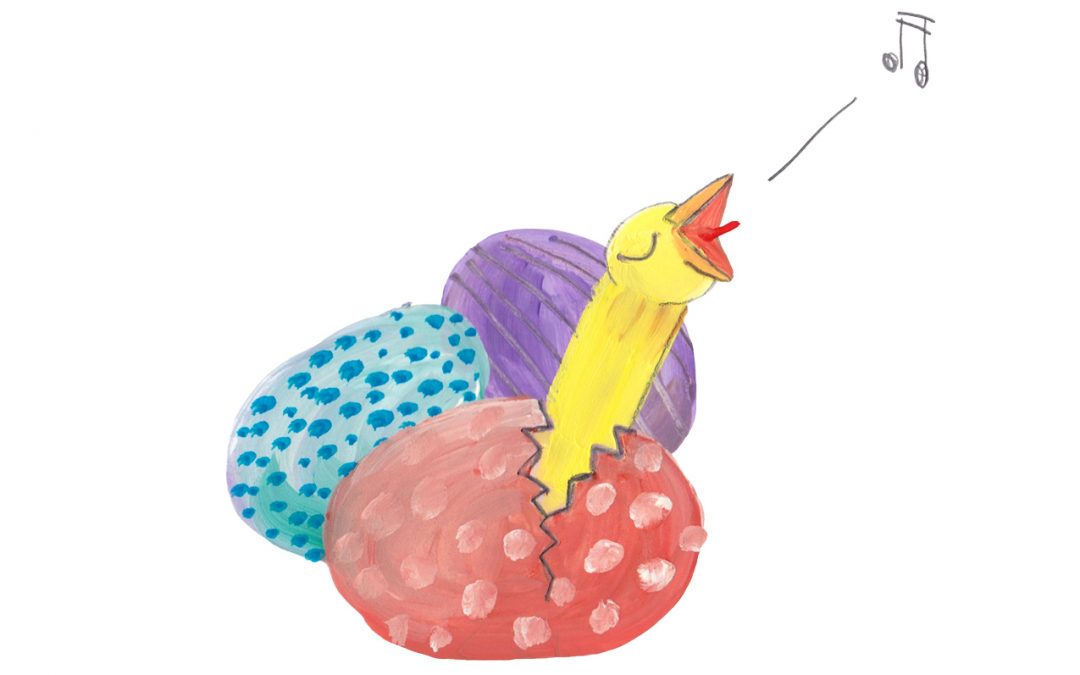
Habiter au cœur des déséquilibres planétaires
Le Centre des Politiques de la Terre souhaite de nouveau soutenir des projets de recherche interdisciplinaire. Il invite ceux·elles souhaitant l’accompagner dans la réflexion sur une ou plusieurs de ses thématiques de recherche à lui soumettre un projet.

Les justices au cœur de la transition sociale et écologique des territoires
Centre des Politiques de la Terre (2023)
Document de travail • Journée d’étude

Une Terre au défi de l’habitabilité. Université et enjeux des savoirs de la Terre
Centre des Politiques de la Terre (2022)
Papier de positionnement
