Ecrire et penser avec l’histoire
Co-responsables: Inès Cazalas et Tatian Monassa
L’axe « Écrire et penser avec l’histoire » structure l’ensemble des travaux du CERILAC portant sur l’écriture de l’histoire (générale ou spécifique, comme le sont les histoires de la littérature, du cinéma, des arts, des sciences, ou encore de l’Histoire elle-même).
Présentation
L’axe « Écrire et penser avec l’histoire » structure l’ensemble des travaux du CERILAC portant sur l’écriture de l’histoire, entendue dans plusieurs acceptions. Cela comprend d’abord l’analyse des modalités permettant de saisir l’Histoire elle-même dans ses multiples temporalités, à partir d’expériences sensibles, de traces mnésiques, de documents, mais aussi de représentations discursives et artistiques. Cela comprend ensuite des réflexions sur « l’écriture de l’histoire » dans son historicité même : distinguer les pratiques scripturaires relevant de l’histoire comme démarche de connaissance de celles relevant de l’histoire comme champ disciplinaire permet de les confronter sans minorer leurs spécificités ni leurs conflictualités. Ces réflexions historiographiques peuvent enfin couvrir l’histoire des arts eux-mêmes (littérature, cinéma, arts visuels), tant dans la manière dont ces arts sont pensés et conçus selon les époques que dans leurs aspects techniques, formels et stylistiques. C’est pourquoi cet axe, dont la dynamique est transdisciplinaire et l’empan transéculaire, réunit à la fois des chercheurs et chercheuses travaillant sur des problématiques proprement historiques – avec ou sans lien direct avec les arts –, et des collègues engagés dans d’autres axes qui souhaitent mettre en exergue les dimensions historiennes de leurs travaux.
À partir de ces faisceaux, plusieurs thématiques de recherche et perspectives théoriques se dégagent.
HISTOIRES, MÉMOIRES
Il s’agit d’appréhender l’histoire dans la pluralité de ses strates, régimes d’historicité et rythmes, depuis les temporalités de « crises » – révolutions, conflits, guerres, génocides, catastrophe – jusqu’au temps long de l’histoire – quotidien, sensibilités, constructions sociales. Sont notamment explorés des phénomènes de retour, de hantise ou de reviviscence du passé, ainsi que des imbrications de lignes temporelles (synchronies, uchronies, anachronismes, constellations). Dans ce cadre, il est possible de questionner ce qui fait événement, période, époque, ou encore ce qui fait témoignage, transmission, trace. L’histoire est alors saisie dans ses multiples textures et au moyen de matériaux divers (documents d’archive, manifestations textuelles, filmiques, scéniques, visuelles ou sonores). Ainsi déployée, l’écriture de l’histoire engage une pensée de l’historicité et de l’historiographie qui cherche à définir ses modes de production comme ses acteurs et actrices, tout en élaborant ses méthodes et sa déontologie.
Une telle approche prend en compte la pluralité des récits (savants, politiques, artistiques, vulgarisateurs) et les dissensus que peuvent créer leurs frottements dans l’espace public, non seulement pour interroger de façon critique la constitution de cultures de la mémoire, mais aussi pour analyser d’autres narrations, d’autres usages du passé et d’autres rapports au présent qui s’inventent dans les sciences humaines et dans les arts. Une attention particulière est accordée aux décentrements postcoloniaux et décoloniaux dans les écritures de l’histoire, qui supposent de questionner la mondialité en prenant en considération les expériences, les récits et les savoirs historiques extra-occidentaux. Enfin, ce décentrement épistémologique est indissociablement lié aux théorisations de la crise écologique qui, en ébranlant l’anthropocentrisme et le naturalisme, conduisent à de nouvelles historiographies, en dialogue avec des réflexions créatrices ad hoc, mais aussi avec des pratiques anthropologiques et avec les sciences du vivant.
APPROCHES GENRÉES ET SITUÉES DE L’HISTOIRE
Dans l’approche transversale qui est celle de l’axe, l’une des orientations pense et écrit l’histoire à partir d’une perspective genrée, en s’intéressant à des figures féminines oubliées au fil des siècles, à l’histoire collective des femmes, à l’analyse de faits sociaux au prisme de la différenciation sexuée des corps, ou encore à la production artistique de femmes et d’autres minorités de genre dans différents domaines. Cette perspective peut s’articuler avec d’autres approches situées (classe, race, orientation sexuelle et/ou affective, âge, capacités physiques), afin de repenser et de réécrire l’histoire en prenant en considération les rapports de pouvoir et la diversité humaine en jeu dans le tissu social, ainsi que leurs imbrications dans la production de savoirs et d’imaginaires.
ARCHIVES : À LA CROISÉE DES TEMPORALITÉS
Une orientation forte des travaux de l’axe, à la fois sur le plan méthodologique et théorique, réside dans la réflexion sur nos relations à l’archive considérée en tant que notion, en tant que document historique, en tant que trace, indice et empreinte du temps, ou encore en tant que production active d’un registre. Qu’elles portent sur l’étude de fonds d’archives précis, sur les différents gestes d’archivage, ou encore sur les modalités d’analyse de documents, ces recherches ne cessent d’interroger les possibilités d’écrire l’histoire à partir de ce qui reste, mais aussi de ce qui manque. Dans cette perspective, des travaux en humanités numériques s’attachent à mettre en lumière la problématique de la disponibilité des documents et de la pertinence des méthodes et des outils contemporains, en tirant les conséquences épistémologiques du principe de l’écart temporel.
HISTOIRES LITTÉRAIRES
Cette dynamique de recherche se déploie dans une grande proximité et complémentarité avec la réflexion sur les archives précédemment évoquée. Elle porte plus spécifiquement sur l’historicité de la notion même de « littérature », dont l’extension comme fait social, institution et ensemble de formes est très variable au fil des siècles. Les processus de littérarisation – ainsi que les débats et tensions auxquels ils donnent lieu – peuvent donc être analysés, en prenant en compte les instances de légitimation, les acteurs et actrices de l’écriture, les conditions matérielles de diffusion ainsi que les processus de réception.
Une telle orientation se traduit par des approches dont les échelles et les prismes sont très variables, mais qui se nourrissent mutuellement : histoire de la notion de « style » ; histoire de la critique littéraire et de l’édition ; approches monographiques d’auteurs et d’autrices dits « canoniques », mais dont la lecture se trouve renouvelée par de nouveaux courants critiques ; mise au jour de figures littéraires ignorées des panthéons nationaux ; attention prêtée à des gestes de création et à des pratiques artistiques transdisciplinaires qui débordent la conception moderne de la littérature centrée sur la figure de « l’écrivain » et sur le texte écrit. Enfin, au sein de l’axe, les approches anthropologiques et comparatistes des histoires littéraires telles qu’elles se sont constituées dans l’espace mondial contribuent autrement au décentrement des objets, à la réflexivité méthodologique, à la mise à l’épreuve de nouveaux outils heuristiques et à l’ouverture de perspectives de recherche.
HISTOIRES DES TECHNIQUES ET DES PATRIMOINES CULTURELS
Au sein des réflexions sur l’historicité des pratiques culturelles, l’histoire des techniques s’affirme comme une approche fructueuse pour penser l’inscription temporelle des objets artistiques, de leurs fabriques et de leurs formes. À l’étude du développement de supports et d’appareils, ainsi que des gestes qui les accompagnent, s’ajoutent des recherches sur les patrimoines culturels dans leur diversité : institutions consacrées à la préservation, à la sauvegarde et à la restauration ; collections aux écritures du temps singulières ; héritages immatériels. Enfin, une réflexion critique est menée sur la notion de patrimonialisation et une attention particulière est portée à d’autres dynamiques de transmission.
Séminaires et rencontres
-
Mardi 9 décembre, 18h-20h, salle 695CRencontre avec Bernard Benoliel autour de son ouvrage Clint Eastwood. Je suis celui que je veux être (Les éditions de l’oeil, 2025) (discussion: Tatian Monassa)
-
Lundi 15 décembre, 18h, Cinémathèque, salle MusidoraPrésentation de la revue Écrire avec l’histoire (pour fêter sa parution intégrale en ligne ainsi que la sortie du dernier numéro coordonné par Frédérique Berthet et Jacques-David Ebguy)
-
Mardi 3 février 17h-19h, salle Seebacher:Rencontre avec Vincent Berthelier autour de son livre Le Style de Marx (Les éditions sociales, 2025) (discussion: Valentine Auvinet et Jacques-David Ebguy)
Membres de l’axe
Publications récentes
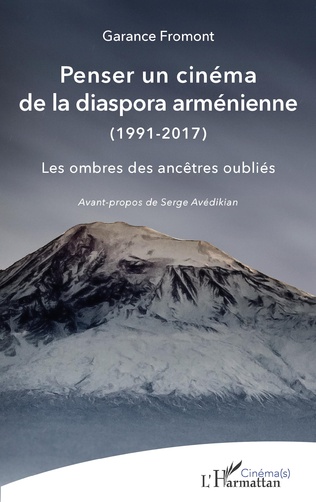
Garance Fromont « Penser un cinéma de la diaspora arménienne »
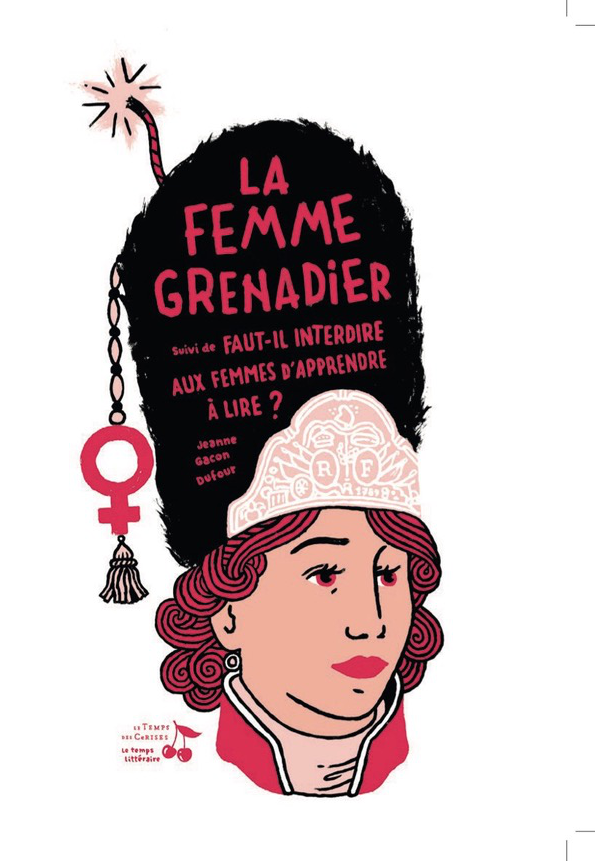
Olivier Ritz édition de « La Femme grenadier » de Jeanne Gacon-Dufour
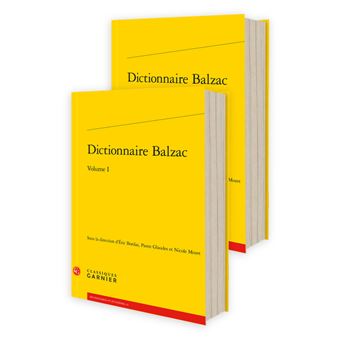
Groupe International de Recherches Balzaciennes (J.-D. Ebguy) « Dictionnaire Balzac »
À lire aussi

« Le manifeste s’éclate » (Itinéraires, 2026)
Retrouvez le nouveau volume d'Itinéraire en ligne autour du thème Le manifeste s’éclateRévolutions contemporaines du manifeste artistique et littéraire, entre théorie et pratique « Le manifeste est mort, vive le manifeste ! » Aujourd’hui plus que jamais, cet adage...
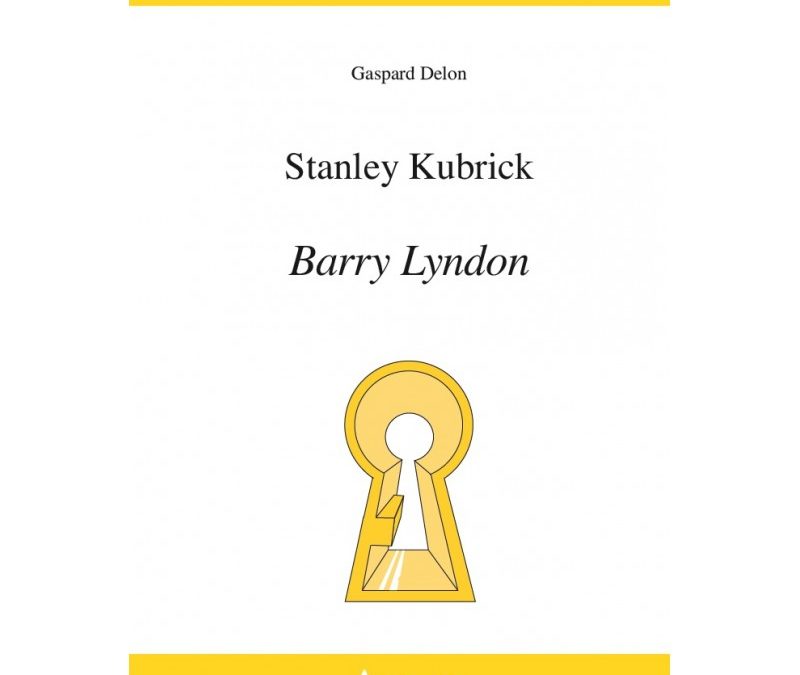
Stanley Kubrick, Barry Lyndon – Gaspard Delon
L'ouvrage porte sur l'œuvre cinématographique au programme de l’agrégation de Lettres modernes en 2026. L’ouvrage propose une analyse du film Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick selon huit axes principaux : -Un film d’auteur à contre-courant -Les mutations d’un...

Séminaire Arts et création au présent 25-26 « Imaginaires contemporains de la création »
Présentation du séminaire 2025-2026 Télécharger le programme au format pdf Qu’en est-il aujourd’hui de la notion de création ? Parce que les figures romantiques de l’artiste démiurge et du génie solitaire ont été mises à mal par l’art lui-même, les artistes...
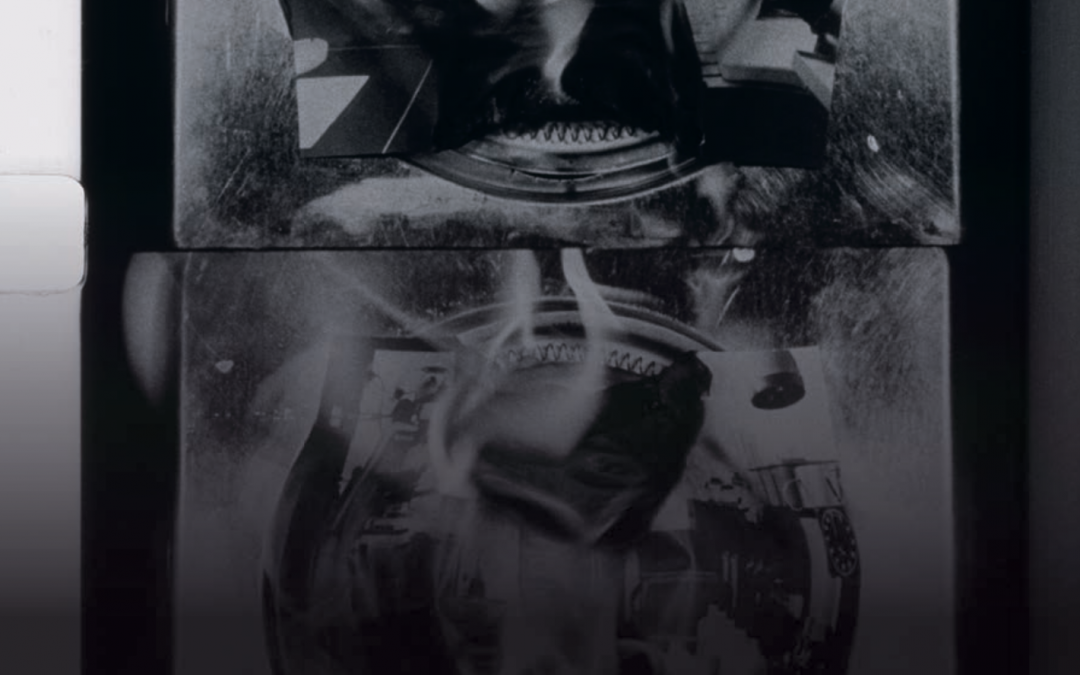
Colloque international « Hollis frampton : From form to idea to form of idea critical thinking and metahistory as acts of research-creation » 18-20 février
Quand 18-20 février 2026 Où Institut national d’histoire de l’art Centre Pompidou hors les murs‑ Centre de l’Université de Chicago Organisé par Enrico Camporesi (Musée national d’art moderne - Centre Pompidou), André Habib (Université de...
