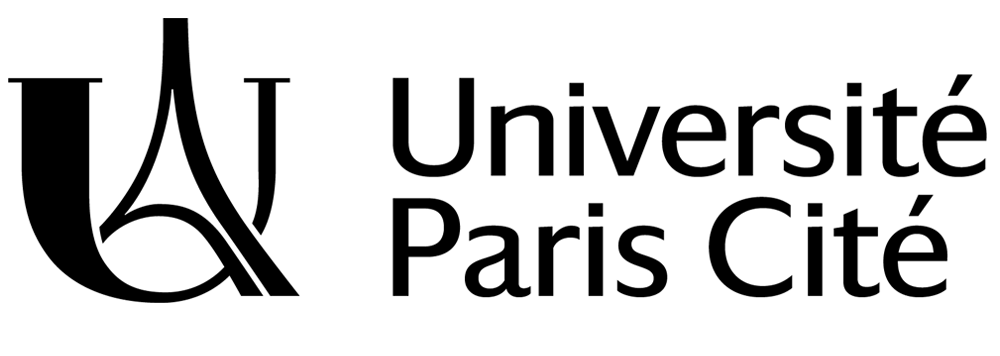Face à une crise d’une telle ampleur, à quoi ressemblera la société demain ? En quoi le marché de l’information tient-il une place prépondérante dans notre perception des risques ? A quels grands changements s’attendre ?
Gérald Bronner, professeur de sociologie d’Université Paris Cité et auteur de plusieurs ouvrages sur les croyances collectives, la rationalité et le principe de précaution, se défend bien de lire l’avenir, mais ses analyses aiguisées et à rebours de certaines idées reçues pourraient permettre d’y voir plus clair.

© Loïc Thébaud
Quelle est votre analyse de cette crise sanitaire ?
Elle doit nous rappeler la nécessité de traiter rationnellement les risques. Notre cerveau est constamment en alerte, on observe tout à toute vitesse. Le problème, c’est que le marché de l’information crée un embouteillage des craintes. Nous sommes submergés par des peurs de toutes sortes : le lait, le gluten, les compteurs Linky, les ondes basse fréquence, les perturbateurs endocriniens… Évidemment, un certain nombre de ces peurs se justifie. Mais si notre attention est sans cesse dispersée par de fausses alertes, cela nous empêche de penser rationnellement la hiérarchie des risques. Et il faut toujours beaucoup plus de temps à la science pour défaire de fausses alertes qu’à un lanceur d’alerte pour en émettre.
Nous n’avons pas vu le danger à temps à cause d’un trop-plein d’informations ?
Ce trop-plein crée une dispersion constante de notre attention. Des travaux de psychologie sociale ont montré que quand on a trop de choix, on suspend notre acte de décision, on est comme « sidéré ». J’ai l’impression que le marché de l’information ressemble un peu à ça. On a pour ainsi dire un panier rempli de produits de la peur, ce qui crée un inconfort permanent, comme si on vivait dans une société complètement empoisonnée. Quand on mélange tout, quand on ne hiérarchise plus les risques, on finit par baisser notre vigilance rationnelle face aux vrais dangers.
Vous avez beaucoup travaillé sur le principe de précaution. Aurait-on dû être plus prudent ?
Le principe de précaution n’a rien à faire ici, il ne concerne pas le danger mais l’incertitude (un risque non probabilisable). La pandémie de Covid-19 c’est un danger clairement établi, qui tue des dizaines et sûrement des centaines de milliers de personnes dans le monde [94 000 victimes au 10 avril]. Impossible de dire qu’on est trop prudent. Mais on assiste déjà au ballet des rétro-prévisionnistes, ceux qui prédisent l’avenir une fois qu’il s’est déroulé et qui « savaient » depuis des semaines que nous courions vers la catastrophe… Il vaut mieux rester humble, et ne pas sombrer dans des raisonnements ex post. Certes il y avait dès janvier des articles qui auraient dû nous alerter, dans Science notamment, mais les États ont préféré aller vers des informations plus rassurantes, et la multitude des informations brouille la lisibilité. Nous-mêmes avons eu envie de croire certaines choses plutôt que d’autres…
Sans devenir devin, comment voyez-vous la suite de cette crise sans précédent ?
A rebours de ce que l’on entend souvent, je dirais que l’on se dirige vers une prise en compte des problèmes au niveau transnational, plutôt que vers un repli national. Je pense à cette pandémie, mais aussi aux problèmes climatiques et migratoires qui ne peuvent être pensés qu’à une échelle internationale. Les dictatures et les régimes populistes pourront toujours essayer de construire des murs, ça ne servira à rien. Il est nécessaire d’imaginer des institutions internationales ayant un vrai pouvoir, car l’expression individuelle des États-nation risque de n’aboutir qu’à un désintérêt collectif.
Pouvez-vous préciser cette idée ?
Les questions énergétiques, alimentaires ou sanitaires doivent relever des États, on le voit à travers cette crise. On attend de l’État qu’il nous protège – ce qu’il fait plus ou moins bien selon les pays. Mais les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés relèvent de flux internationaux. La gestion des tests, des masques et de l’information sur cette épidémie ne devrait pas être laissée aux mains des nations. C’est ce qui a permis à la Chine de rendre inaudibles les lanceurs d’alerte au début de l’épidémie. Concernant les masques, à quoi bon avoir en France un stock de cinq milliards de masques au sortir de la crise ? La décision la plus rationnelle serait de donner un stock minimum à chaque pays, tout en se dotant d’un stock massif rapidement déployable n’importe où sur la planète dès qu’une épidémie fait son apparition.
Comment analysez-vous la place de la science dans cette crise ?
Je n’ai pas de données précises sur la question, mais de manière un peu schématique je distinguerais trois phases. La première c’est « l’infodémie » telle que décrite par l’OMS, avec des informations venant de Chine, qu’on regardait de loin, et un peu de haut. La deuxième phase c’est le danger qui se rapproche de nous, avec la peur qui s’installe. Cette peur a semblé nous conduire vers une certaine rationalité et un besoin d’écouter les médecins. La troisième phase, c’est celle du confinement. Et là, tout le monde semble redevenir un petit savant… On voit fleurir les théories du complot – les données de recherche sur Google montrent un pic de recherches sur le thème du complot au début de ce confinement –, la controverse autour de la chloroquine et de la figure du professeur Raoult, la thèse d’un virus créé en laboratoire, etc. On retombe ici dans ce que je décrivais dans La démocratie des crédules [paru aux PUF en 2013], à savoir une difficulté à ordonner toutes les informations. Tout ce qui fait que la cartographie de la peur ne recouvre pas celle de la rationalité.
Ne pensez-vous pas qu’après cette crise la société sera malgré tout plus à l’écoute de ce que disent les scientifiques ?
Le problème c’est que la science doit toujours s’exprimer avec une certaine humilité, en tenant compte du caractère incertain et provisoire de ce qu’elle affirme. En période de risque, c’est encore plus dur à admettre. Les gens veulent au contraire des réponses claires et fermes : quand le confinement va-t-il prendre fin ? Quand les écoles vont-elles rouvrir ? C’est désespérant de ne pas avoir ces réponses ! Je dirais qu’il faut surtout faire attention à ce que la figure du scientifique ne se retrouve pas instrumentalisée, comme ce fut le cas pour justifier le maintien des élections municipales qui était une décision strictement politique. C’est la fonction du politique d’assumer les incertitudes dans la gestion de la cité, il ne doit pas se servir de la science comme d’un paratonnerre.
Que pensez-vous de l’idée que « plus rien ne sera comme avant » après cette crise sans précédent ?
On disait déjà cela après la Première guerre mondiale, la fameuse « der des der »… Je pense qu’il y a une grande naïveté anthropologique là-dedans. Évidemment il va y avoir quelques changements dans nos comportements. Quand une épidémie apparaîtra, on la prendra un peu plus au sérieux, on va guetter le retour du Covid-19, on va sans doute faire des stocks de masques… Pour le reste, je pense que la vie va reprendre comme avant. Beaucoup d’études montrent qu’après une catastrophe, les gens ont une logique assurantielle. On paie un peu plus cher pour se garantir contre le risque, mais tous les assureurs vous le diront, après un certain temps c’est oublié. Il faut lire le livre d’Hervé Flanquart à ce sujet, Des risques et des hommes [paru aux PUF en 2016].
On entend pourtant beaucoup parler d’un changement radical quant au modèle de société…
Selon moi on a plutôt affaire à une auberge espagnole de l’opportunisme idéologique, où chacun voit ce qu’il a envie de voir : la fin du capitalisme, un rappel de la nature, etc. Bien sûr la mondialisation induit de nouveaux dangers, avec les interactions humaines, les voyages, le commerce international… Mais la peste au Moyen Âge a causé des ravages bien plus importants. Notre modernité ne peut être balayée aussi rapidement. La puissance de la recherche scientifique, l’efficacité de la décision publique, la vitesse à laquelle circule l’information sont des éléments cruciaux dans notre combat contre cette pandémie. Sans taire les responsabilités liées à cette crise, il nous faut accepter que les malheurs du monde puissent malheureusement n’avoir aucun sens.
Entretien réalisé le 3 avril 2020
À lire aussi

Syndrome coronaire aigu : des premiers résultats prometteurs dans la recherche contre la récidive
À la suite d’un syndrome coronaire aigu (SCA), le risque de récidive d’événement cardiovasculaire majeur (nouvel infarctus, accident coronaire ou décès) est particulièrement élevé. En cause, une inflammation résiduelle ou chronique pour laquelle il n’existe...

Consommation de conservateurs : deux études alertent sur un risque accru de cancer et de diabète de type 2
Une consommation plus élevée d’additifs alimentaires conservateurs, utilisés dans les aliments et les boissons transformés industriellement pour prolonger leur durée de conservation, a été associée à une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2. Ces...

Une mère sur quatre concernée par des soins irrespectueux en maternité
S’appuyant sur l’Enquête nationale périnatale de 2021, une équipe de chercheuses associant notamment l'Université Paris Cité révèle qu’un quart des mères en France seraient concernées par des soins irrespectueux en maternité, associés à un risque accru de dépression...

Meet-Up 2025 : plus de 100 participants réunis pour les sessions d’information organisées par l’Université Paris Cité sur les appels européens MSCA Postdoctoral Fellowships
Afin d'offrir aux post doctorantes, aux post doctorants et à leurs superviseurs le meilleur soutien possible pour une candidature réussie et de grande qualité aux appels MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA PF), le Réseau Recherche Europe, coordonné par l’Université...