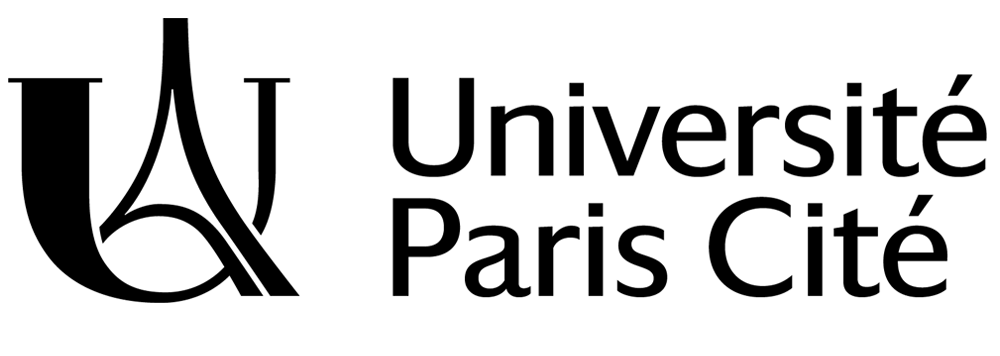Historienne des sciences et de l’environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphere (Université Paris Cité – CNRS) et autrice de nombreux livres sur la nature et l’environnement, Valérie Chansigaud revient sur les liens entre la crise mondiale que l’on traverse et notre rapport à la nature.

Qu’est-ce que l’histoire des sciences nous apporte durant cette période et comment l’articulez-vous avec votre travail sur l’environnement ?
Tous les débats environnementaux que l’on connaît sont construits sur les connaissances produites par les scientifiques : elles peuvent être utilisées comme des outils de réglementation ou réduites à des armes brandies dans les débats de sociétés, voire niées par une portion importante de la société. L’environnement est un terrain de recherche qui valorise l’histoire des sciences et, surtout, l’envisage d’une façon nettement plus sociale et culturelle. Les dynamiques historiques, comme les acteurs, sont très différents dans ce champ par rapport à l’histoire des sciences plus traditionnelle.
Cette crise sans précédent nous donnerait-elle l’occasion de renouer avec la nature ?
On déplore la perte du lien entre l’homme et la nature depuis toujours. L’humain aurait vécu heureux dans le jardin d’Éden, puis aurait tout détruit en voulant accéder à la connaissance… Il n’y a pourtant jamais eu d’harmonie. L’arrivée de l’homme en Amérique du Sud, il y a 12 000 ans, coïncide avec l’extinction d’environ 70 espèces d’animaux. Son arrivée à Madagascar aboutit à la disparition de la totalité des mammifères de plus de 40 kilos. La colonisation des îles du Pacifique entraîne l’extinction de 400 à 2 000 espèces d’oiseaux, sur 10 000 espèces référencées dans le monde aujourd’hui. Évidemment tout cela s’est accéléré avec les sociétés industrielles, mais il faut casser ce cliché de rupture avec une harmonie préexistante.
La crise sanitaire n’est donc pas une « vengeance » de la nature ?
Ce n’est pas tant la nature qui se venge que l’humain qui s’est montré incapable de tirer de la sagesse des expériences antérieures pour empêcher la catastrophe. Au fond l’émergence d’un nouveau pathogène était extrêmement prévisible. Sur les cinquante dernières années, leur nombre n’a fait qu’augmenter : le Sras et le Mers bien sûr, mais aussi Ebola, la fièvre du Nil occidental, le Chikungunya, la dengue, le VIH… ça n’arrête pas. Et on peut étendre la liste aux plantes et aux animaux confrontés à tout un tas de pathogènes introduits par l’action de l’homme, comme par exemple la peste porcine africaine qui dévaste les élevages de porcs européens notamment. Dans l’un de mes livres (1) je parlais d’un « phénomène de réitération ». L’être humain ne fait que reproduire toujours les mêmes catastrophes sans en tirer le moindre enseignement. C’est tellement récurrent que ça relève plus de la psychiatrie que de la philosophie…
Comment expliquer notre aveuglement et quelle solution proposer ?
Les mesures à adopter pour éviter les catastrophes sont assez simples, en revanche leur mise en place demanderait tellement d’efforts que la plupart des gens ne veulent même pas en entendre parler. En voyageant – même en prétendant faire très attention – on sait qu’on prend le risque d’introduire des maladies n’importe où. Je peux citer l’exemple d’un champignon européen introduit en Amérique du Nord et y ravageant les chauve-souris, ou celui d’un champignon chinois introduit en Europe et ayant décimé les salamandres. Il aurait pourtant suffi de bien laver ses bottes infectées après une balade dans une grotte ou en forêt, mais qui aurait supporté de faire cela ? On sait aussi que manger des animaux sauvages risque de faire émerger de nouveaux pathogènes, mais on va quand même en consommer parce que leur attrait est plus fort que la rationalité – le pangolin, comme la biche ou le gibier chez nous, est consommé pour se distinguer socialement. Il faut, à mon sens, arrêter de penser que l’être humain est rationnel et qu’il prend ses décisions en fonction de la « meilleure » solution possible à sa disposition…
Cette crise semble donner des arguments à tous ceux qui se battent pour changer notre rapport à l’environnement et nos modes de consommation. Quel est votre point de vue ?
On constate que depuis leur apparition au milieu du XIXe siècle, les mouvements pour la protection de la nature viennent quasiment tous, à quelques exceptions près, des classes moyennes et supérieures. Pourtant les problèmes environnementaux ont des impacts pour le moins inégalitaires, les ouvriers étant bien plus touchés que les cadres par les polluants. Concernant la consommation, on remarque qu’il est plus facile de faire la promotion de la frugalité quand on est riche. Des chercheurs ont relevé que dans les classes les plus riches se développent des modes de consommation ultra-frugaux. Ne pas trop dépenser finit par devenir une forme de distinction sociale, ce que le sociologue Thorstein Veblen avait bien décrit dès la fin du XIXe siècle. Son œuvre est fascinante pour comprendre que la réussite sociale c’est à la fois consommer mais aussi pouvoir s’abstenir de consommer. L’imbrication des questions sociales et environnementales produit un discours inaudible pour une partie des concitoyens qui préfèrent ignorer les problèmes actuels.
Comment analyseriez-vous les répercussions de la crise actuelle ?
Demander à un historien sa vision de l’avenir c’est se plonger dans un bain d’angoisse : les crises n’apportent jamais de sagesse. Si on prend un exemple précis comme les maladies affectant les arbres, on se rend compte que toutes les crises (la spongieuse, la graphiose de l’orme, le flétrissement du frêne, le chancre coloré du platane) suivent un même scénario depuis le début du XXe siècle : introduction d’un pathogène, ignorance délibérée des lanceurs d’alertes, adoption de mesures drastiques mais prises trop tard, production d’un volume considérable de connaissances scientifiques, mise en place de dispositions réglementaires et, pour finir, affirmation unanime d’un « plus jamais ça ! ». Pourtant, les crises se succèdent, voire s’accélèrent. Je ne vois pas par quel miracle la crise actuelle, qui va durer des années voire des décennies, nous rendrait plus vertueux. Le plus probable est que l’on fera comme avant, mais en pire. Pour pouvoir manifester de l’optimisme, il faudrait qu’on ait un plan. Le problème c’est que les environnementalistes expliquent bien tout ce qu’il faut arrêter et interdire, mais ils sont incapables de proposer un projet attractif à même de réunir toutes les couches sociales pour aboutir à un consensus. Arrêtons de penser que nous avons perdu un rapport harmonieux avec l’environnement et tâchons au contraire, pour la première fois de notre histoire, de concevoir un système moins destructeur de l’environnement.
(1) Valérie Chansigaud, La nature à l’épreuve de l’homme, Delachaux, 2015
À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation
L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité
Créé en décembre 2024, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...