La dépression se caractérise, entre autres, par une tendance à percevoir de façon excessivement négative les stimuli sensoriels et les situations de la vie quotidienne. Des chercheuses et chercheurs de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec des psychiatres du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, de l’Inserm et du CEA, ont décidé d’explorer l’amygdale et d’observer son fonctionnement lors d’épisodes dépressifs. Ils ont mis en évidence que l’état dépressif induirait une altération de certains circuits neuronaux spécifiques, avec une réduction de l’activité des neurones impliqués dans la perception agréable des stimuli positifs, et au contraire une suractivation de ceux responsables de la perception des stimuli négatifs. Ces résultats, qui pourraient aider à mettre au point de nouveaux médicaments pour les personnes résistantes aux traitements classiques, ont été publiés dans la revue Translational Psychiatry en septembre 2024.

Entre 15 et 20 % de la population traverse, à un moment ou un autre de sa vie, un épisode dépressif, à savoir « un état de profonde détresse qui dure ». Cependant, 30 % des patients souffrant de dépression sont résistants aux traitements médicamenteux classiques que sont les antidépresseurs. Pour mettre au point de nouvelles thérapies, il est donc indispensable de mieux connaître les mécanismes sous-jacents à l’état dépressif, notamment ceux qui induisent un « biais de négativité ».
En effet, la dépression conduit les patients à percevoir le monde et l’ensemble des stimuli sensoriels de façon excessivement négative – les stimuli agréables deviennent moins attrayants et les stimuli désagréables plus aversifs –, ce qui favorise le développement et le maintien des symptômes dépressifs.
« On sait aujourd’hui que l’amygdale est impliquée dans l’appréciation de la valeur émotionnelle des stimuli environnementaux, qui entraîne l’attraction ou la répulsion, mais aussi qu’elle joue un rôle dans la dépression », rappelle Mariana Alonso, co-auteure principale de cette étude et chef du groupe Circuits émotionnels, au sein du laboratoire Perception et action à l’Institut Pasteur. « Plus récemment, le rôle de certains circuits de neurones spécifiques de l’amygdale dans la perception positive ou négative des stimuli environnementaux a été mis en évidence, mais nous n’avions encore jamais observé l’altération de ces circuits lors d’un épisode dépressif ».
Pour en savoir plus sur l’implication de ces circuits dans le biais de négativité, des chercheurs de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec des psychiatres du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, de l’Inserm et du CEA, ont donc décidé d’étudier l’activité de l’amygdale chez un modèle murin de la dépression. Comme chez les patients bipolaires dépressifs, ces modèles murins manifestent un comportement dit d’anxiété et de stress (négligent leur toilette, rasent les murs, se réfugient dans le noir) et répondent à des stimuli olfactifs avec un biais de valence négative (sont très peu attirés par des odeurs d’urine femelle d’ordinaire attractives pour les souris males et très fortement repoussés par des odeurs de prédateur).
« Pour étudier le fonctionnement de l’amygdale lors de la dépression, nous avons mesuré l’activité de certains réseaux de neurones impliqués dans l’interprétation plus ou moins négative des stimuli olfactifs », précise Mariana Alonso. Les scientifiques ont alors pu mettre en évidence que dans un état dépressif, les neurones préférentiellement impliqués dans le codage des stimuli positifs sont moins actifs que d’ordinaire, tandis que les neurones préférentiellement impliqués dans le codage des stimuli négatifs sont fortement sollicités. Autrement dit, la dépression semble induire un dysfonctionnement des circuits de l’amygdale impliqués dans le codage des stimuli environnementaux, qui lui-même favoriserait le biais de valence négative caractéristique de la dépression.
Ces données sont extrêmement précieuses pour mettre au point de nouveaux traitements pour les personnes dépressives mais aussi les personnes atteintes de troubles bipolaires, qui connaissent des variations de l’humeur qui sont disproportionnées dans leur durée et leur intensité. « Nous avons réussi à inverser, au moins partiellement, le biais émotionnel négatif induit chez la souris, et le comportement dépressif associé, en suractivant les neurones impliqués dans le codage positif des stimuli environnementaux. C’est une piste intéressante à explorer pour la mise au point de nouveaux traitements », souligne Mariana Alonso. « Nous explorons maintenant chez l’homme, si la guérison d’un épisode dépressif dépend de la restauration de l’activation de ces réseaux neuronaux », conclut Chantal Henry, professeure de psychiatrie à l’université Paris Cité, psychiatre au centre hospitalier de Sainte-Anne et chercheuse au sein de l’unité Perception et action à l’Institut Pasteur.
Références
Disrupted basolateral amygdala circuits supports negative valence bias in depressive states, Translational Psychiatry, 19 septembre 2024
À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre
À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...
lire plus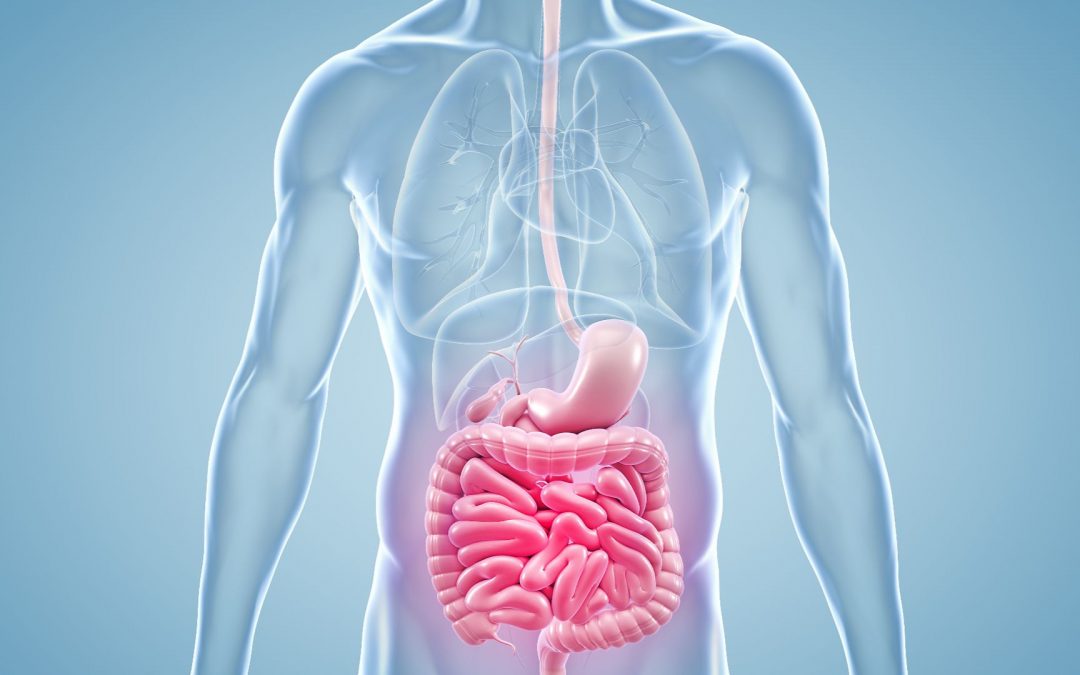
Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense
Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...
lire plus
Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal
Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...
lire plus