Sous l’impulsion de chercheurs et enseignants-chercheurs du Centre d’Épidémiologie Clinique (AP-HP), des unités CESP (Inserm/Université Paris-Saclay/UVSQ/Gustave Roussy) et CRESS (Inserm/Université Paris Cité), ComPaRe, la Communauté de Patients pour la Recherche de l’AP-HP, a mené une étude de science citoyenne pour recueillir les idées des patientes souffrant d’endométriose en vue d’améliorer leur prise en charge. Les 1000 participantes de l’étude ont répondu à 1 question et proposé 2487 idées regroupées en 61 axes d’amélioration.
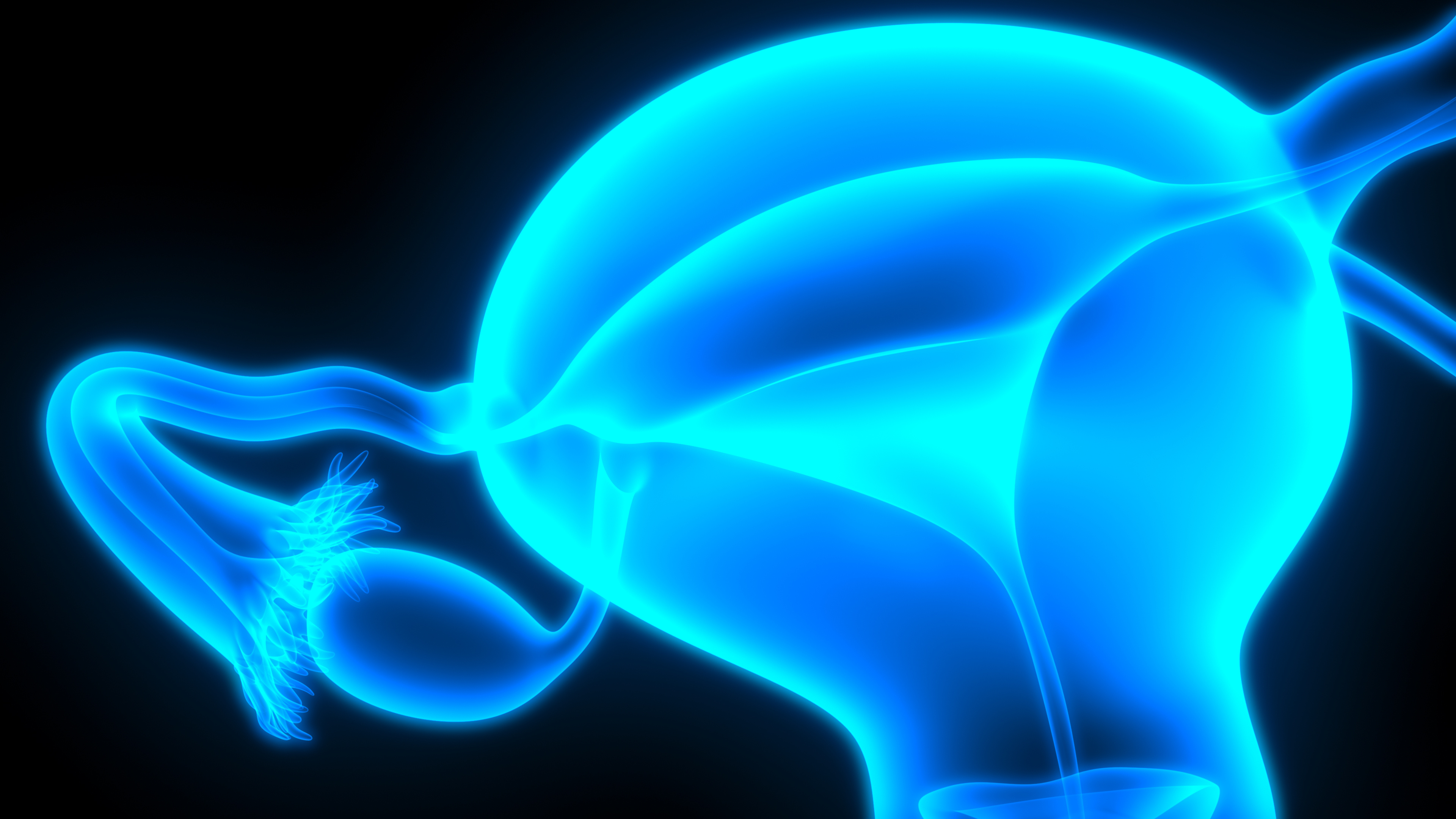
La question était la suivante : « Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge ? ». 2487 idées ont été proposées et regroupées en 61 axes d’amélioration. Menée par Solène Gouesbet, doctorante à l’Université Paris-Saclay, et supervisée par le Dr Viet-Thi Tran, épidémiologiste et co-investigateur de ComPaRe (Université Paris Cité / AP-HP), l’étude a fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue Journal of Women’s Health le 19 janvier 2023.
L’endométriose est une maladie gynécologique pouvant causer de nombreux symptômes invalidants (douleurs pelviennes lors des règles ou lors des rapports sexuels, troubles digestifs, fatigue…). Cette maladie touche environ 10% des femmes en âge de procréer, mais malgré cette prévalence élevée, on estime à environ sept ans le délai entre l’apparition des premiers symptômes et le diagnostic de la maladie.
Les options thérapeutiques sont limitées et de nombreuses femmes vivent avec des douleurs non résolues. Peu d’études dans la littérature1 prenaient en compte le point de vue des patientes.
1000 patientes de la cohorte ComPaRe Endométriose ont été sélectionnées aléatoirement. La question ouverte « Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge ? » leur a été posée sous la forme d’un questionnaire dans leur espace personnel ComPaRe. Les données ont été analysées par un groupe comprenant à la fois des chercheurs, des soignants et des patientes. Grâce aux participantes de l’étude, près de 2500 idées ont pu être identifiées, regroupées en 61 axes d’améliorations.
Les pistes d’améliorations des patientes étaient l’amélioration de la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants (41%), l’amélioration des soins et un accompagnement pour des problématiques spécifiques à l’endométriose (25%), ou encore l’assurance d’un diagnostic précoce avec un meilleur processus de diagnostic et un support adapté (22%).
« J’aurais aimé être diagnostiquée plus tôt pour me mettre en aménorrhée rapidement, cela m’aurait évité bien des journées sans pouvoir aller en cours, en étant en souffrance (…) » témoigne une patiente.
L’intelligence collective des patientes capturée au cours de cette étude va permettre de définir un modèle de prise en charge plus adapté au vécu des patientes. Une fois de plus, ComPaRe fait du patient un acteur de la recherche sur sa maladie.
À l’occasion de cette publication, ComPaRe Endométriose remercie toutes les participantes et relance son appel à la participation. En s’inscrivant sur ComPaRe (https://compare.aphp.fr/endometriose/), les patientes contribuent à faire avancer la recherche médicale publique sur leur maladie et font entendre leur voix.

Créée en 2017 par l’AP-HP, ComPaRe, la Communauté de Patients pour la Recherche rassemble aujourd’hui plus de 50 000 patients volontaires partout en France. Ils contribuent à faire avancer la recherche sur leur(s) maladie(s) chronique(s) en répondant régulièrement aux questionnaires en ligne des chercheurs, sur la plateforme sécurisée https://compare.aphp.fr.
Les patients participent à la cohorte générale et/ou à l’une des quatorze cohortes dédiées au diabète, à la maladie de Verneuil, au vitiligo, à la lombalgie chronique, aux maladies rénales, aux vascularites, à l’hypertension artérielle, à l’endométriose, aux neurofibromatoses ou au syndrome de Marfan.
Références
Patients’ Perspectives on How to Improve Endometriosis Care: A Large Qualitative Study Within the ComPaRe-Endometriosis e-Cohort
Solène Gouesbet, Marina Kvaskoff, Carolina Riveros, Élise Diard, Isabelle Pane, Zélia Goussé-Breton, Michelle Valenti, Marie Gabillet, Camille Garoche, Philippe Ravaud, et Viet-Thi Tran. Journal of Women’s Health
À lire aussi

Lancement du Club Innovateurs de l’université Paris Cité
Le 3 juillet 2024 s’est tenue la réunion de lancement du Club Innovateurs de l’université Paris Cité au Liberté Living Lab. Cette initiative réunit des chercheuses et des chercheurs employés ou hébergés par UPCité, ayant obtenu un concours...

Du 11 au 14 septembre 2024, les sciences humaines et sociales investissent la Cité
Autour de trois grandes thématiques en lien avec les valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques - jeux & créativité, rivalités, migration & racisme - venez découvrir ou re-découvrir les sciences humaines et sociales lors des Olympiades Humanités et sciences...
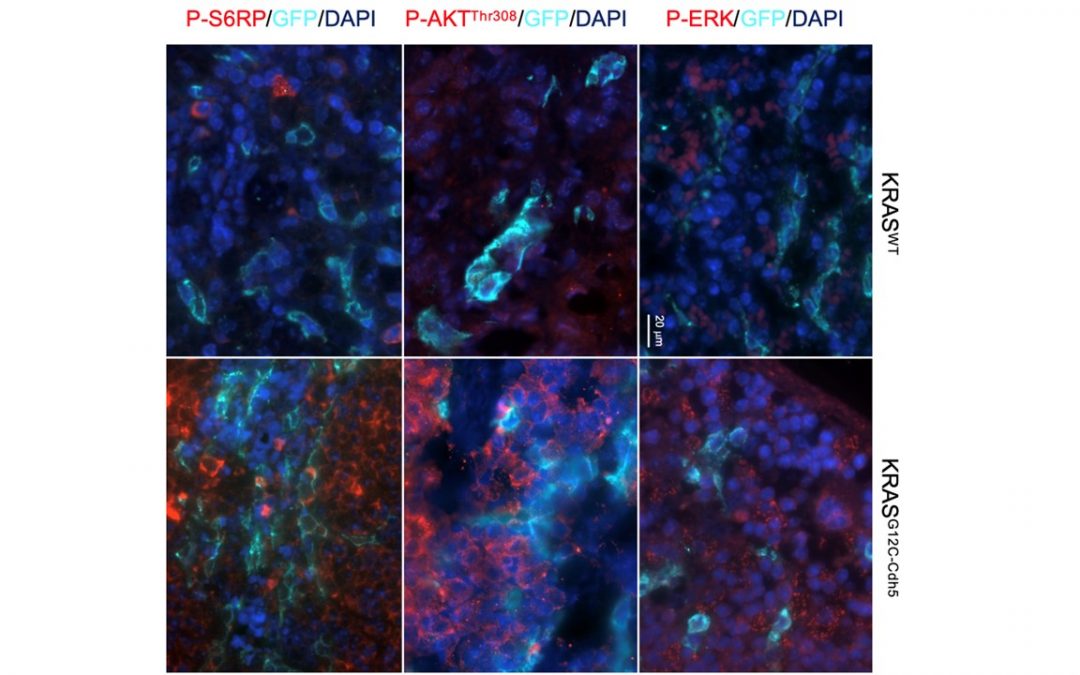
Malformations artérioveineuses : nouvelle approche thérapeutique prometteuse pour les patients
Les équipes de l’unité de médecine translationnelle et thérapies ciblées de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’Inserm, de l’université Paris Cité au sein de l’Institut Necker–Enfants Malades, coordonnées par les professeurs Guillaume Canaud (Université Paris...

À vos marques !
Endurance, force, souplesse et équilibre… L’application Tous en forme permet de tester rapidement sa condition physique. Un moyen de prévention dans un contexte où sédentarité et inactivité menacent la santé publique. Téléchargez l'application dès maintenant : sur...
