Des équipes des services de maladies infectieuses et tropicales des hôpitaux de l’AP-HP Raymond-Poincaré et Bichat – Claude-Bernard, d’Université Paris Cité, de l’Université Paris-Saclay et de l’Inserm, ont mené des travaux sur les données cliniques de patients infectés par le Covid-19 lors de la vague d’Omicron par rapport aux vagues précédentes. Pour évaluer l’impact du variant Omicron en Ile-de-France, les équipes de recherche ont étudié les caractéristiques de 225 248 patients inscrits sur Covidom*, dont 72 394 patients infectés lors de la vague Omicron.
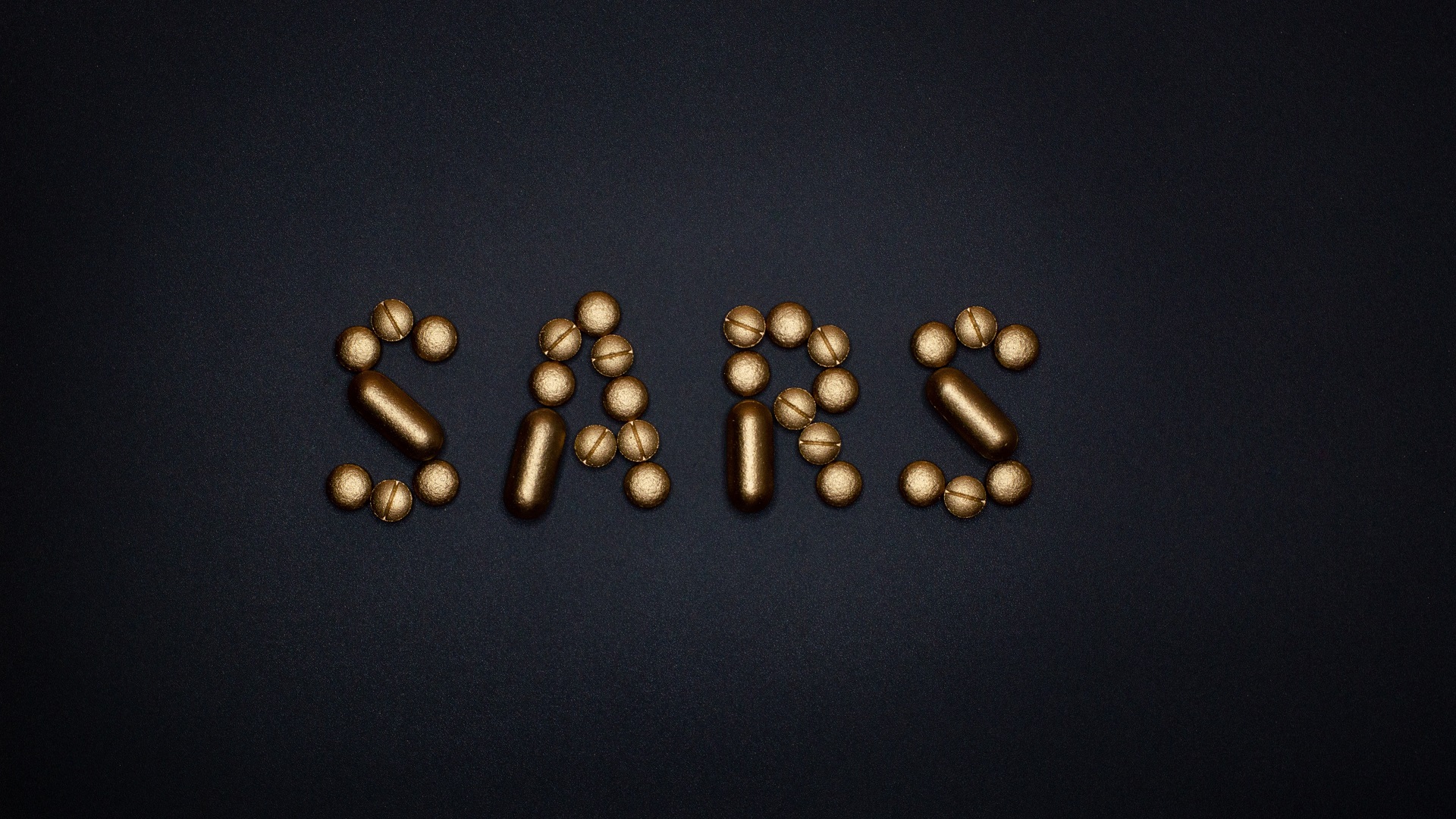
Pour mener ces travaux, les équipes de recherche ont réalisé une étude de cohorte incluant des patients adultes, avec le diagnostic de Covid-19, infectés entre le 9 mars 2020 et le 11 janvier 2022 et suivis par la plateforme Covidom, une solution de télésurveillance pour le suivi à domicile des patients atteints de Covid-19 en Ile-de-France.
Dans le cadre de la plateforme Covidom, les patients, inclus dans l’étude par un médecin ou après un test positif, remplissent quotidiennement des questionnaires auto-administrés sur les symptômes pendant 10 à 30 jours selon l’évolution des symptômes. Les données renseignées par les patients comprenaient : la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, les signes cliniques systémiques (fièvre, fatigue, étourdissements, frissons, tachycardie ou myalgie), les signes cliniques respiratoires (toux, essoufflement, douleur thoracique, oppression thoracique) et les signes cliniques digestifs (nausées/vomissements, diarrhée).
Selon des seuils prédéfinis, ces données pouvaient déclencher deux types d’alertes : une alerte orange pour une priorité modérée ou une alerte rouge signifiant une priorité absolue avec un patient dont l’état clinique peut se détériorer. En plus de ces données déclarées par les patients, le nombre d’hospitalisations et/ou de déclenchements de SAMU a également été enregistré.
Les travaux menés montrent que lors de cette vague Omicron, l’âge moyen des patients suivis grâce à la plateforme Covidom était inférieur et que ces patients présentaient moins de comorbidités que lors des vagues précédentes de Covid-19. La proportion de patients présentant des signes de difficultés respiratoires pendant la vague d’Omicron était aussi significativement moins importante que lors des vagues précédentes (49% pendant la vague d’Omicron versus 85,6% pendant la première vague). Le nombre de cas recensés étaient lui bien supérieur à celui des vagues précédentes.
La proportion du nombre d’hospitalisations (0,06% vs 0,2% à la vague 1, et 2, vs 0,5% à la vague 3 et vs 0,3% à la vague 4) et/ou de déclenchements de SAMU ((0,1% vs 0,4% à la vague 1, vs 0,2% à la vague 2, vs 0,5% à la vague 3 et 4) était proportionnellement moins importante durant la vague Omicron.
Ces données confirment l’importance quantitative soit 72 394 cas (vs 42 328 à la vague 1, 46 338 à la vague 2, 46 610 à la vague 3, 17 578 à la vague 4) de la vague Omicron en Ile-de-France mais aussi sa moindre gravité. Cependant, considérant le nombre total de cas, cette vague Omicron constituait une possible menace de débordement du système hospitalier.
Covidom est une application de e-santé développée par Nouvéal e-santé et mise en œuvre par l’AP-HP qui permet aux patients de bénéficier d’un télésuivi à domicile via des questionnaires médicaux, et le cas échéant de contacts téléphoniques avec les opérateurs d’une plateforme de télésurveillance régionale médicalisée.
Références
Impact of Omicron surge in community setting in greater Paris area – Aurélien Dinh, Lotfi Dahmane, Mehdi Dahoumane, Xavier Masingue, Patrick Jourdain, François-Xavier Lescure
DOI : https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.02.015
À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation
L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité
Créé en décembre 2024, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...
