Une étude majeure dans la prise en charge des patients atteints de cancer et traités pour un événement thromboembolique veineux (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire), deuxième cause de décès, a été menée et coordonnée par la Pr Isabelle Mahé, Université Paris Cité, cheffe du service de médecine interne de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP. Il s’agit du premier essai académique international à avoir évalué l’efficacité et la tolérance d’une stratégie anticoagulante au-delà des six premiers mois de traitement, et démontrant que la dose réduite d’apixaban, un anticoagulant oral, est à la fois aussi efficace et plus sûre que la dose pleine. Cette étude prospective randomisée en double aveugle multicentrique, promue par l’AP-HP et coordonnée par l’URC Lariboisière Saint-Louis, a été menée dans 136 centres en Europe (Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne et Suisse) et au Canada de 2018 à 2024.
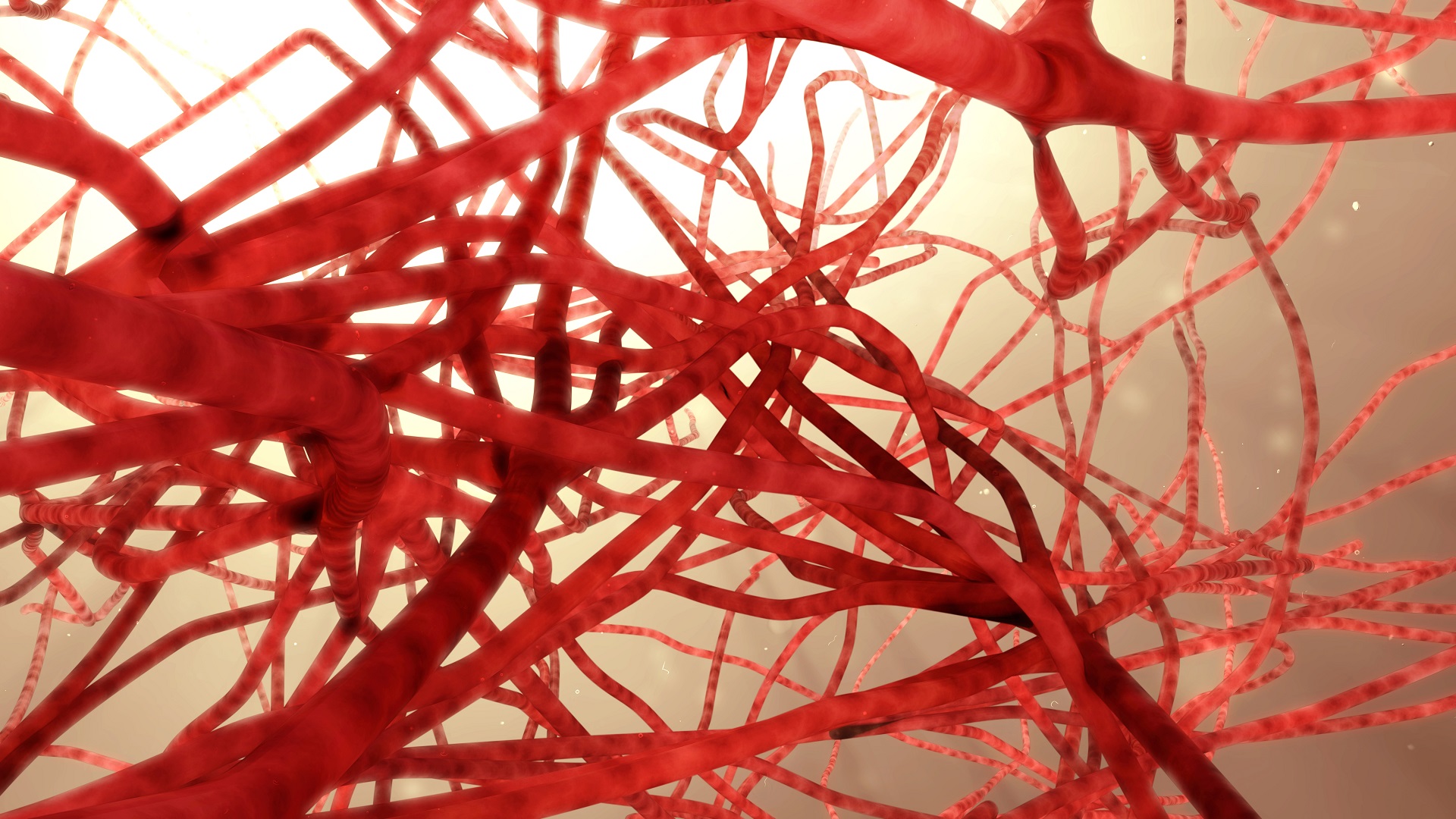
© Tous droits réservés
La thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire, présentations de la maladie thromboembolique veineuse (TEV), sont une complication fréquente du cancer et la deuxième cause de décès chez les patients atteints de cancer, après le cancer lui-même. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ce risque TEV : les cellules cancéreuses libèrent des substances qui favorisent la coagulation, facilitant ainsi la formation de caillots sanguin ; le traitement du cancer peut également favoriser une inflammation des vaisseaux sanguins et augmenter le risque de formation de caillots sanguins. La chirurgie et la pose de dispositifs invasifs contribuent également à expliquer ce risque TEV.
Actuellement, les recommandations internationales préconisent un traitement anticoagulant pour les patients atteints de cancer qui développent un événement TEV pendant au moins six mois, et tant que le cancer reste actif ou que le traitement du cancer est en cours. Des études ont montré que, bien que le risque de récidive d’événement TEV diminue après six mois de traitement anticoagulant, les patients restent exposés à un risque de récidive d’événement TEV élevé, justifiant la poursuite du traitement anticoagulant pour le prévenir, et les exposant alors à un surrisque d’hémorragie.
L’objectif de l’essai prospectif randomisé en double aveugle multicentrique API-CAT, était d’évaluer si la dose réduite d’apixaban avait une efficacité comparable à la dose pleine pour prévenir le risque de récidive de TEV chez les patients atteints d’un cancer actif ayant reçu un traitement anticoagulant d’au moins six mois pour un événement TEV. Si cet objectif était atteint, le second objectif était d’évaluer si la dose réduite permettait une réduction du risque d’hémorragie cliniquement pertinente par rapport à la dose pleine.
Au total, 1 766 patients atteints d’un cancer actif, âgés de 67 ans en moyenne, ont été inclus dans 11 pays, dont 57 % de femmes. 65,8 % avaient un cancer métastatique et 81,2 % recevaient un traitement anticancéreux au moment de l’inclusion.
Les patients ayant participé à l’étude ont été randomisés en deux groupes : un groupe a reçu un traitement par 2.5 mg deux fois par jour (dose réduite) et le second un traitement par 5 mg deux fois par jour (dose pleine) d’apixaban pendant 12 mois. Ni les patients ni leurs médecins ne savaient quelle dose les patients recevaient jusqu’à la fin de l’essai. Tous les décès, les suspicions de récidive de TEV et les hémorragies survenues pendant l’essai ont été examinés par un groupe indépendant de médecins.
Le critère d’évaluation principal de l’étude était toute récidive de TEV ou tout décès dû à une TEV pendant la période de traitement. Le critère d’évaluation secondaire était le composite de saignements majeurs et de saignements ayant nécessité le recours à des soins médicaux.
À 12 mois, 18 patients dans le groupe à dose réduite et 24 dans le groupe à dose pleine ont présenté une récidive d’événement TEV, soit une incidence cumulée à 12 mois respectivement de 2.1% et 2.8%, représentant une différence statistiquement significative en faveur de la non-infériorité de la dose réduite par rapport à la dose pleine. Des saignements cliniquement pertinents nécessitant des soins médicaux sont survenus chez 102 patients du groupe recevant la dose réduite, contre 136 patients du groupe recevant la dose pleine, soit une incidence cumulée à 12 mois respectivement de 12.1% et 15.6%, représentant une réduction statistiquement significative en faveur de la supériorité de la dose réduite. Les taux de décès étaient similaires dans les deux groupes, soit une incidence cumulée à 12 mois respectivement de 17,7 % dans le groupe à dose réduite et de 19,6 % dans le groupe à dose pleine.
« Nos résultats montrent que, chez les patients atteints d’un cancer actif ayant reçu au moins six mois de traitement anticoagulant pour un événement TEV, un traitement prolongé avec une dose réduite d’anticoagulant par apixaban ne s’accompagne pas d’augmentation du risque de récidive d’événement TEV, et permet de réduire le risque de saignement cliniquement pertinents de 25 % par rapport à une dose pleine. Nous pouvons donc affirmer que la dose réduite d’apixaban est à la fois aussi efficace et plus sûre que la dose pleine. » conclut la Pr Isabelle Mahé, Université Paris Cité, cheffe du service de médecine interne de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP.
Ces résultats devraient conduire à une mise à jour des recommandations internationales, concernant un traitement prolongé chez les patients atteints d’un cancer actif qui ont déjà reçu un traitement anticoagulant pendant au moins six mois pour le traitement d’un événement TEV, en faveur d’un anticoagulant à dose réduite.
Cette étude internationale menée dans 10 pays Européens et au Canada, a été conduite et coordonnée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en totale indépendance de l’industrie qui n’est intervenue ni dans la conduite de l’étude, ni dans l’analyse des résultats et dans la rédaction de l’article. Elle a fait l’objet d’un financement par l’alliance BMS-Pfizer.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors du congrès The American College of Cardiology ce samedi 29 mars 2025.
Références
Extended Reduced-Dose Apixaban for Cancer-Associated Venous Thromboembolism
Liste des 136 centres investigateurs : Hôpital Louis Mourier AP-HP (1), CHU de Saint Etienne – Hôpital Nord (2), Hôpital Privé Arras Les Bonnettes (3), CHU Amiens-Picardie (4), CHU Grenoble Alpes (5), CHRU Bordeaux – Hôpital Saint André (6), CHU de Dijon – Hôpital François-Mitterrand (7), CHU de Rouen – Hôpital Charles-Nicolle (8), CHU de Brest- Hôpital de La Cavale Blanche (9), Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne sur Mer (10), CHU de Nice – Hôpital Pasteur (11), CHU de Montpellier – Hôpital Saint Eloi (12), Hôpital Privé Jean Mermoz (13), CHU de Nantes (14), Hôpital européen Georges Pompidou AP-HP (15), CHD Vendée (16), Clinique du Parc – Castelnau Le Lez (17), CHU Timone (18), Hôpital Tenon AP-HP (19), Centre hospitalier Lyon Sud (20), CHU Limoges – Hôpital Dupuytren (21), CHU Clermont-Ferrand (22), Centre Hospitalier des Pays de Morlaix (23), CHU de Caen (24), Hôpital d’Instruction des Armées Clermont Tonnerre (25), Hôpital Avicenne AP-HP (26), CHU Angers (27), Hôpital Cochin AP-HP (28), CH du Mans (29), Hôpital Mignot (30), Institut Curie (31), Hôpital René Huguenin- Institut Curie (32), Centre d’oncologie de Gentilly (33), Institut Saint Catherine (34), Hôpital Beaujon AP-HP (35), Centre de radiothérapie – Clinique Ste Anne (36), Hôpital Jean Minjoz (37), Hôpital Henri Mondor AP-HP (38), Hôpital Foch (39), Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (40), Hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP (41), CHU de Brest – Hôpital Morvan (42), Groupe Hospitalier Paris Saint -Joseph (44), Hôpital CHI de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (46), Centre Eugène Marquis (47), Polyclinique Courlancy (48), Centre Léon Berard (49), Centre Paul Strauss (51), Institut Gustave Roussy (52), Clinique de l’Estrée (54), CH Cholet (55), HIA Percy (56), Hôpital Paul Brousse AP-HP (57), Hôpital Saint Antoine AP-HP (58), Hôpital Bichat AP-HP (59), CH Emile Roux Le Puy en Velay (60), Clinique de l’Infirmerie Protestante de Lyon (61), CH de Saint Malo (62), CH Avignon (63), CH Métropole Savoie (64), CHU Rennes (65), Hôpital Nord-Ouest – Villefranche sur Saône (66), Hôpital Henri Mondor AP- HP (67), Hôpital Mutualiste Villeurbanne (68), Hôpital côte de Nacre (69), GH Sud IdF, Melun (70), Vienne (101), Medical university of Graz (103), Linz (105), Louvain (201), Institut Roi Albert II – Bruxelles (202), CHC Saint-Joseph – Liège (203), Bruxelles (204), Liège (205 et 206), Courtrai (207), Barcelone (301), Hospital universitad la Paz – Madrid (302, 306, 318, 319 et 323), Gerone (303 et 311), Barcelone (304 et 305), Hospital universitario Infanta Sofia – Madrid (306), Albacete (307), Séville (308), Alicante (309), Ciudad Real (310), Carthagène (313), Pamplona (315 et 321), Santiago (316), Valence (317), Varese (401), Perugia (402), Ravenna (403), Chieti (408), Castelfranco (410), Beverwijk (501), Leiden (503), Amsterdam (504), Almelo (505), Apeldoorn (506), Dordrecht (507), Hilversum (508), Utrecht (509), Sittard-Geleen (510), Medical university of Bialystok (602), Gdanski Uniwersytet Medyczny, Gdansk (605), Otwock (609), University clinical hospital in olsztyn (611), Oncology Clinic of Karol Marcinkowski, Pozna (613), Warsaw (614), Lausanne (701), Genève (702), BELLINZONA -IOSI, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli (703), Zurich (704), Liverpool (805), Cottingham (807), Oxford (810), University Hospitals Birmingham – NHS Foundation Trust Birmingham (815), Athens (901, 902, 903 et 904), Ottawa (851), Toronto (852), London (853), Hamilton (854), Halifax-QEII Centre for Clinical Resaerch (855), Edmonton (857), Calgary (858) et Vancouver (859).
À lire aussi

Journée mondiale contre le cancer : une mobilisation collective de la Faculté de Santé

Abraha et Pierre : une amitié au service de la mémoire des peuples en temps de guerre
À Paris, les chemins de deux historiens se croisent. L’un arrive d’Éthiopie, portant avec lui des carnets remplis d’observations quotidiennes rédigées pendant la guerre du Tigré. L’autre, français, est spécialiste de l’histoire contemporaine éthiopienne. De cette...
lire plus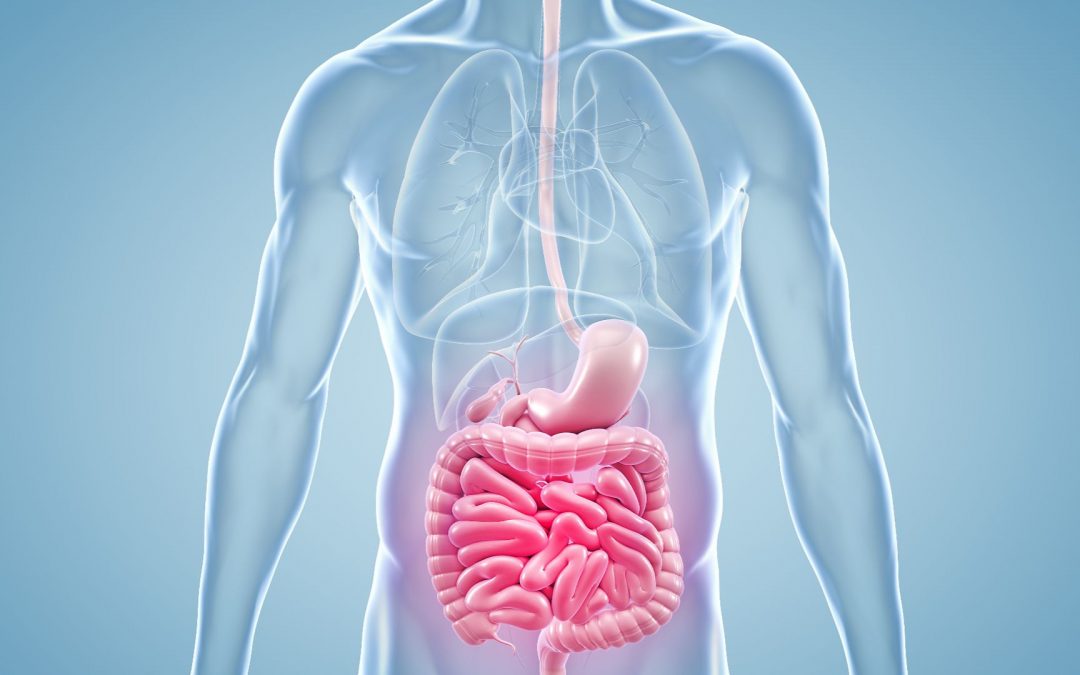
Le rôle clé de la communication intestin-cerveau dans le circuit de la récompense
Menée par Oriane Onimus, doctorante soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale, et dirigée par Giuseppe Gangarossa, professeur à l'Université Paris Cité, une étude publiée le 30 janvier 2026 dans la revue Science Advances révèle que les mécanismes de la...
lire plus
Prédire le risque d’infection chez le nouveau-né grâce au microbiote vaginal
Sous la coordination du Pr Laurent Mandelbrot (Université Paris Cité), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP, des équipes de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Inserm, de l’Institut...
lire plus